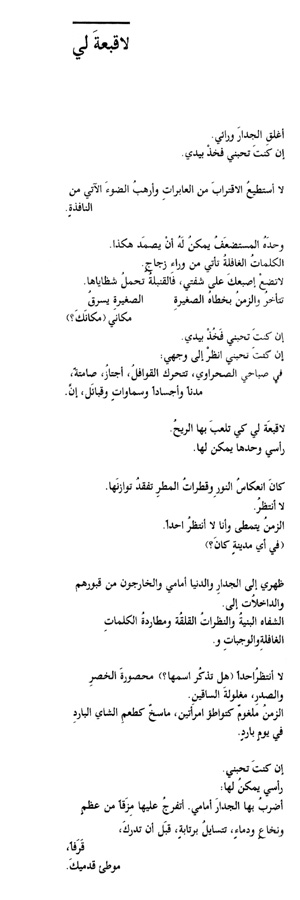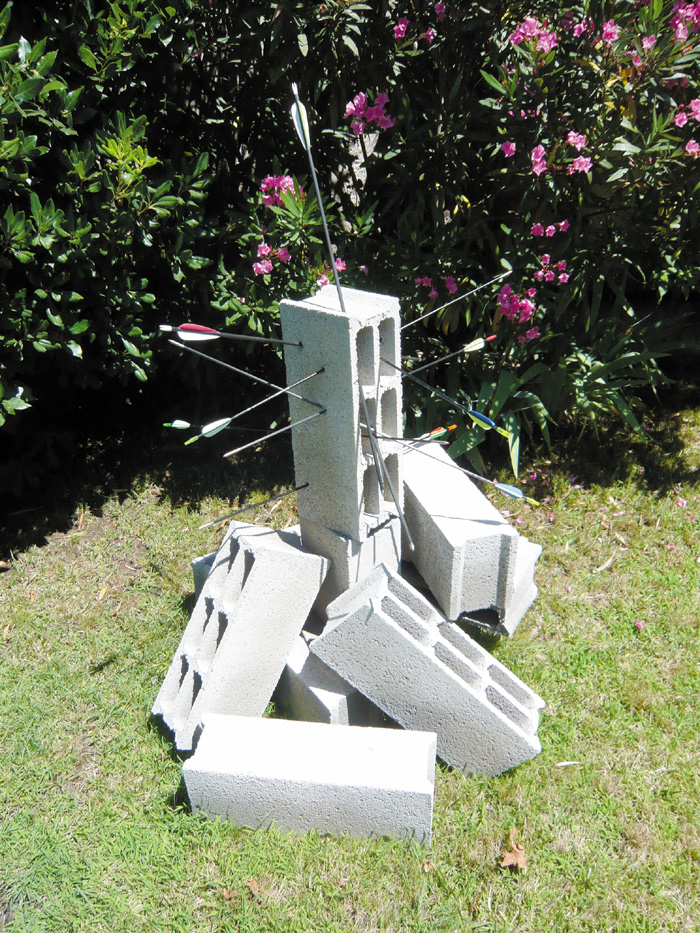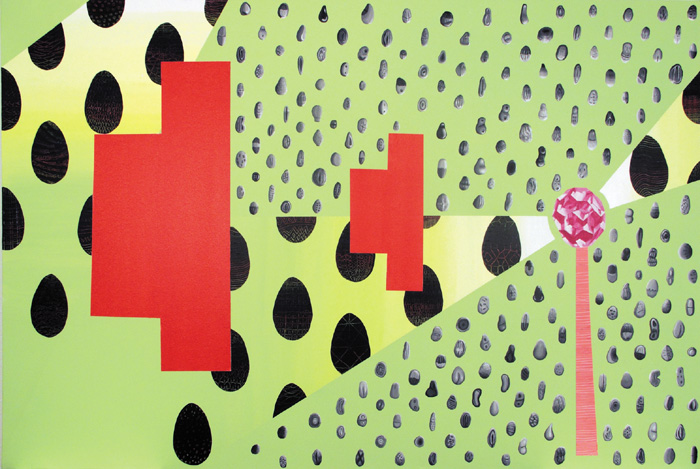SOMMAIRE
Ça passe par l'Art - The
American Gallery
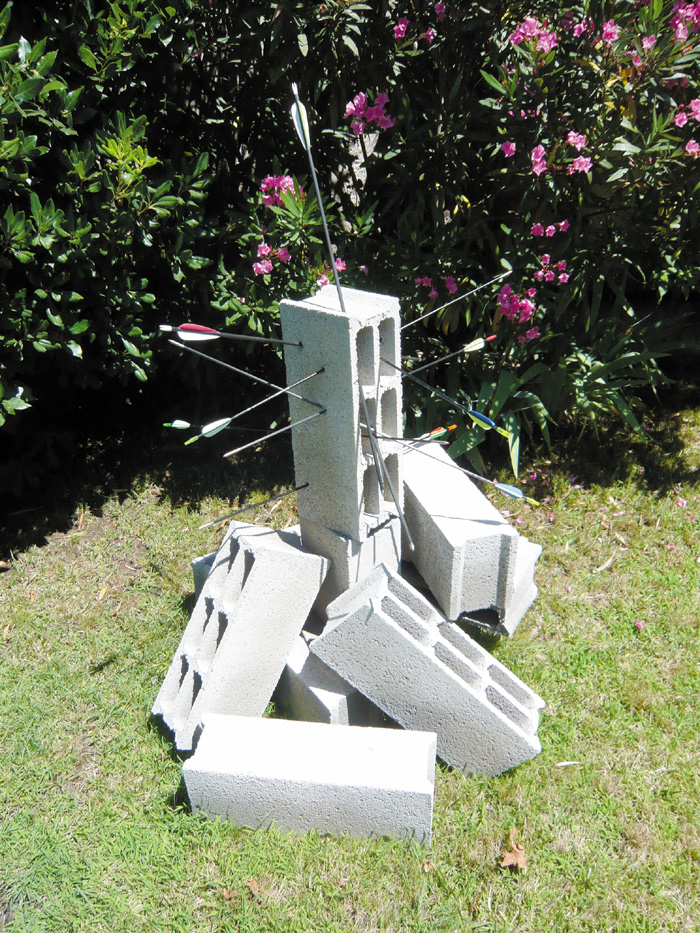 Laurent Perbos, «Martyr», Photographie Florent Joliot
Laurent Perbos, «Martyr», Photographie Florent Joliot
Ça
passe par l'Art
par Florent Joliot
L'ouverture d'un nouveau lieu,
«The American Gallery» fut l'occasion de redécouvrir ailleurs, le
travail de deux artistes invités à l'actualité régionale chargée.
En effet, alors que Patrick Guns (Galerie Polaris) terminait son
exposition à la Galerie of Marseille, Laurent Perbos inaugurait une
exposition personnelle au CAC à Istres.
Ailleurs n'a pas toujours du sens ; Aussi, localement s'interroge t-on
fréquemment sur la légitimité hors représentation, de cette
re-présentation systématique que font les artistes de leur travail,
fâcheuse habitude d'occupation des lieux, saut de puces qui n'ont pour
effet que de lasser le visiteur.
Ici le lieu diffère en tout, véhiculant une fraîcheur nouvelle dans la
relecture des travaux.
En effet, c'est à son domicile que Pamela King qui porte ce projet
accueille les visiteurs. Situé sur les hauteurs de Bompard, cet espace
débute par un jardin en restanques pour se terminer par une terrasse
surplombant le vallon et la mer, une invitation au voyage, à
l'ouverture, qui dialoguant, trouve son antonyme dans le lieu intimiste
que constitue en sous-sol la galerie proprement dite. Pamela King
invite les artistes à investir l'ensemble de ces espaces à l'occasion
d'évènements, réunions, échanges franco-Américains, le lieu restant
ouvert sur rendez vous.
Pour son ouverture, la galerie, effectue un grand écart artistique en
exposant ces deux artistes à l'approche et au langage formel pour le
moins éloignés, affirmant sa volonté d'approche libre et transversale
du champ de l'art contemporain, misant sur la complexité du lieu pour
cimenter l'ensemble. Et ça fonctionne !
L'exposition débute par la pièce «StainBlood» présentant au mur des
javelots transperçant des balles de tennis, œuvre de Laurent Perbos qui
occupant l'ensemble du jardin trouve un terrain de prédilection à
l'installation décalée de ses œuvres dans un parcours récréatif.
En effet, cet artiste qui pratique l'art du ready-made, prélève le
motif de ses installations dans le champs des activités de
divertissement, des activités de masse. Puis, détournant les objets par
le geste de l'art (l'objet étant altéré dans sa forme, son matériau ou
sa destination), il les réinjecte ensuite dans un contexte qui
participe à leur parasitage, différant ainsi le message initial que
l'objet transmet en tant que «mythologies sociales», pour céder la
place un instant à son caractère purement plastique, sculptural.
Face à ces formes ovoïdes, cette accumulation de tuyaux d'arrosage, ce
tas de parpaings criblés de flèches, on s'interroge immanquablement
«mais qu'elle est donc cette chose qui me dit quelque chose ?» pour
constater une fois le titre connu «M&M's», «Souches»,
«Martyr».que le jeu est définitivement terminé.
Perbos joue avec le statut de l'oeuvre d'art, et par son appropriation,
il entend brouiller la piste qui nous lie à l'objet, nous invitant à
réfléchir sur la manière dont l'histoire de ses formes est ancrée en
nous ; Et si d'aventure l'objet se lit immédiatement dans sa fonction,
c'est à travers la matière que l'altération procède, comme dans sa
série «Parpaings» qu'il décline dans des matériaux improbables, métal,
bois, résine, jusqu'à devenirs mous !
Dans son travail, Perbos s'attelle à révéler le caractère sculptural
intrinsèque à l'objet et pour ce faire il le débarrasse de ses
différentes couches de sens ; Ce qui pose en creux, une fois lissé, une
fois «design-é», l'importance de cette charge sociale que l'objet
conserve.
Ici, la dimension ludique de son travail se retrouve jusque dans sa
présentation : «les souches» composées de tuyaux d'arrosages retrouvent
leur place en entrée de jardin, les «M&M's» comme friandises le
temps d'un vernissage, tandis que le «Martyr» et «le feu de néons» nous
invitent non sans humours, à poursuivre notre parcours jusqu'au travail
de l'artiste suivant ; L'ensemble s'insérant parfaitement dans la
promenade comme un petit jardin d'agrément, une mise en bouche joyeuse
avant de plonger dans l'espace de la galerie en sous-sol.
La galerie quant à elle se prête particulièrement bien à la pesanteur
du sujet traité par Patrick GUNS, l'espace tout en longueur présente
son travail «My Last meal», proprement et froidement exposé comme il se
doit, pour terminer sur un diaporama percutant occupant le mur du fond.
«My Last meal» est un travail en cours, initié par Patrick GUNS il y a
quelques années alors que heurté par le cynisme d'une publication qu'il
découvrait sur le site Internet du département de la justice du Texas,
divulguant publiquement une liste des derniers repas commandés par les
condamnés à mort avant leur exécution, il décidait : «d'en exacerber le
goût en le tirant du côté de la Vie et par là même d'affirmer mon
opposition à la peine capitale.» Ce disant, il confie la liste des
repas à des chefs cuisiniers de renommée, leur proposant d'exécuter
celui de leur choix dans une réinterprétation du dernier vœu du
condamné, dans un geste d'offrande «humaniste», d'hommage à l'être en
tant qu'humain «Il me semble que seul un artiste du palais peut
interpréter ce choix, célébrer les agencements et les compositions
chromatiques à travers sa présentation, et ses couleurs, dans une
apologie de la Vie face à la mort décidée.» Ainsi Patrick Guns,
laissant libre cours à l'interprétation du chef, immortalise-t'il
l'événement sous la forme d'un assemblage texte-image distancié. Alors
que le texte dévoile la composition du menu rédigé dans une typographie
grasse qui varie arbitrairement à chaque condamné, lui donnant ainsi un
corps personnifié ; A sa droite l'image, prise de vue frontale Illustre
le chef en pied dans sa cuisine, présentant le repas exécuté.
Curieusement le procédé induit que le sujet ne reste pas le plat (que
l'on distingue à peine), mais le cuisinier qui figure lui-même le
condamné à la postérité. Comme la nourriture passe par le corps, cela
passe par les corps.
En effet, si l'on regarde les images ainsi réalisées avant d'en
connaître la genèse, il est frappant de constater la tension et le
malaise qui s'en dégage en particulier à cause de l'attitude des
personnes représentées qui hésitent entre faire honneur comme il se
doit au condamné à travers la présentation de leur plat (tentant un
rictus, une ébauche de sourire), et l'absolue gravité de la situation.
La posture étant simplement intenable.
Ce travail pose de nombreuses questions...
Il aurait été problématique qu'il soit esthétisant, et le discours, le
choix du cadrage distancié, de l'image réduite participent d'une
certaine forme de pudeur, de volonté d'humanisme (naïf ?) affirmé ;
Mais cette redondance d'une esthétique froide et frontale, l'usage de
la police différenciée, ainsi que les cartels qui spécifient le nom du
condamné à mort, celui de l'état dans lequel il à été exécuté, la date
de la mise à mort ainsi que le nom du chef, de la ville où il officie,
et la date de l'exécution du plat sur un même plan sémantique,
participent tous d'un certain maniérisme qu'il y a lieu d'interroger
lorsque l'on traite un tel sujet. À cela s'ajoute le décalage
comico-tragique entre la simplicité de la requête des condamnés qui a
trait à des plats et des goûts le plus souvent hérités de l'enfance, et
leur exécution réinterprétée par des grands chefs à la renommée
internationale.
L'artiste place le spectateur-voyeur dans la même posture intenable que
le cuisinier et c'est de là que se dégage toute la force de ce travail
: dans sa capacité à véhiculer le malaise à travers les corps.
Il est à noter qu'aucun des chefs Americains sollicités n'a accepté de
participer au projet jusqu'ici. En dehors de la forme, l'exposition de
ce travail pour l'inauguration prend donc tout son sens dans ce lieu
amené à être hautement fréquenté par des Américains.
Ainsi, l'ambiguïté relative à la forme de ce travail artistique nous
amène tout naturellement à nous interroger sur la possibilité ou pas de
retranscrire dans une quelconque forme un tel sujet, un tel propos, et
en cela pose la question des limites de tout travail artistique
conceptuel et politique traité et réalisé comme tel. Limite que pour ma
part je place dans l'intention conceptuelle elle-même de traiter en
substance un tel thème. Du pur concept intenable dans le réel tout
comme la peine de mise à mort elle-même.
F.J.
Laurent Perbos
Patrick Guns
juillet 2010 (exposition clôturée)
American Gallery - contemporary art
10 bis, rue des Flots Bleus, 13007 Marseille
Pamela King - Tél. : 06 27 28 28 60
the.american.gallery@free.fr
Renseignements : Sandra Karkos 06 63 04 56 03
Florent Joliot - Photographe +33 (0)6 63 04 56 03
flo.joliot@gmail.com
Ça passe par l'Art - The
American Gallery
|
SOMMAIRE
Festival SENTIER ARTE E NATURA
- Queyras et Piémont - été 2010
 Luciano di ROSA
Luciano di ROSA
LAND
ART EN GRANDEUR NATURE
par Emmanuel Loi
Le disparate en art provient de
plusieurs sources : les lieux pour montrer des productions faites pour
être cloîtrées ont longtemps dicté leur histoire. S'accumulaient
pendant des décennies et des lustres dans des réserves des œuvres
pillées (talismans, fragments de l'usufruit d'une conquête) qui étaient
sorties à des intervalles réguliers et que visitaient des regards
nostalgiques pas toujours tendres. Reliques et poteries, statuaires,
pyramides. Les lignes de force de l'art à ciel ouvert ne se lisent pas
de façon anthropomorphique ; la poigne de l'homme, la façon dont il a
imposé à la nature énergumène son sillon, se lit dans les temples.
C'est en cela que la poussée de l'art environnemental se distingue de
l'art monumental, de la vétusté des nécropoles où même les parutions
les plus acides, les plus immédiatement moulées par la commande
publique et le goût dominant prennent date et eau. La prise de
conscience du danger croissant de l'agression de l'homme sur sa
biosphère joue aussi dans le domaine des arts plastiques où nous avons
vu évoluer sémantiquement le passage de land art à création in situ,
sur le site.
Si le pasteur Oberlin écrivait à l'abbé Grégoire en juillet 1787 : «je
dois écrire sur ce que je ne sais point», il en reste de même pour le
critique. Il se forme comme une ligne de résistance où la marque
d'attachement au territoire se ferait d'autant plus grande que la
promenade, le parcours du baladin tendent à se réduire. L'intervention
de l'artiste en pleine nature ne peut se passer de chemin. Pour
l'édition 2010 de SAN Sentier Art Nature, onze artistes montrent chacun
deux œuvres, en Italie et en France.
Les œuvres ne sont pas disparates. Le cadre de présentation des oeuvres
détermine un accompagnement, il faut marcher, crapahuter, grimper,
mériter pour saisir le point de vue de J-F Marc près d'une bergerie ou
voir la pirogue évanescente de Polska à 2000 m sur un étang. La notion
d'effort et de récompense sont le pendant d'une oisiveté ou d'un flirt
paysager, certains travaux ont la chance ou la faculté de se trouver au
bord d'un ruisseau, d'un petit pont ou à l'entrée d'un parcours
initiatique. Comment se fait le choix d'opérer à tel endroit pour tel
artiste, cela dépend-il de la difficulté de l'œuvre, du maillage
identitaire du bornage ou un pur caprice aléatoire ? La difficulté
d'accès du terrain, l'incongruité de la proposition, le défi technique,
autant de paramètres que le directeur artistique D. Boisgard définit
comme une alliance, un abécédaire du désir. Certains artistes profitent
d'un enchaînement temporel, ils sont invités à plusieurs reprises.
Spécialisés dans ce type d'interventions, ils connaissent les modes
opératoires de prescription.
 Arnaud de LA SABLIERE
Arnaud de LA SABLIERE
Deux projets s'appuient l'un
sur l'autre. Au sein du programme ACCOTRA,
partenariat de jumelage frontalier soutenu par l'Europe, Grandeur
Nature propose des résidences pendant trois semaines en juillet à
quatre jeunes artistes, cette année Guillaume Légué, Laure Moulié,
Vianney Cottineau et le talentueux Gaspard Struelens. Le but de ces
résidences est de tisser des liens avec le territoire en impliquant des
artisans locaux. Etudiants en écoles d'art et venant de toutes les
régions de France, leur séjour artistique dans le Queyras se clôt par
la monstration de leur travail in situ. Cinq conférenciers, de Nadine
Gomez à Gilles Tiberghien ont animé des débats sur l'expérience de
l'art contemporain in situ. Des projections grand public sous les
étoiles clôturent chaque journée de marche.
L'autre projet Sentier Arte e Natura, lui aussi projet franco-italien
qui fédère la région Piémont et la région du Queyras veut développer un
partenariat d'itinéraires où sont égrenées un nombre d'œuvres.
Pour Stéphanie Cailleau qui a habillé deux gros rochers de laine sur
lesquels elle a fait émerger de drôles de plantes avec morceaux de
plastique fondus et fermetures Eclair, ses Anémones d'alpage
appartiennent autant au conte de fées qu'à un nouveau métissage,
l'hybridation des éléments et débris industriels trouvés dans les
alpages (morceaux de vêtements de randonneurs, K-Way, polaires
abandonnés, vieux joggings) s'opère et les fleurs synthétiques,
pudiques et insolites laissent apparaître des morceaux de monde.
Pascal Mirande a conçu des guérites qui tiennent à la fois de la cabine
de plage que du poste frontière. Par un judas, on peut lire une
citation d'auteur, de Leonard de Vinci à Max Jacob. D'un format
impraticable, ces six cabines occupent l'espace comme les graines
perdues d'un chapelet. L'apposition d'une œuvre dans le paysage qui ne
veut jouer que de l'insolite s'essouffle assez vite.
Par contre, le plan d'Olivier de Sépibus marche du tonnerre. Au col
d'Agnel à plus de 2500 m, il a de part et d'autre de la frontière et du
mont dominant, disposé deux angles de galets rouges qui forment les
angles apparents d'un iceberg enfoui, d'un monument ancien recouvert
par la caillasse. Comme il dit : «Lorsque nous partons à la montagne en
effet, nous attendons que le paysage regardé corresponde au corpus
d'images pittoresques et romantiques que nous avons tous en nous. Nous
voudrions que tout nous soit révélé et évident du premier coup d'œil.»
Si le spectateur, l'automobiliste, au prix d'une course harassante dans
une côte à plus de 14% par endroit ne saisit pas le double volet de la
construction imaginaire, il ne jouit pas de l'astuce du privilège du
plan préétabli. Associé à un sac de sable de poste militaire par
certains promeneurs, cette œuvre ambitieuse nécessiterait peut-être une
signalétique antérieure en plusieurs étapes sur les flancs du col afin
de capter l'audace du schéma extrêmement elliptique.
Jean-Yves Piffard a rassemblé des pierres pour former au bord des deux
sentiers des fours à pain et à tourbe traversés par des arbustes
écorchés et passés à l'argile pour former des étagères. Il a fabriqué
des plaquettes d'argile qui forment un livre d'une page rehaussé à
chaque fois de l'empreinte de la main et les a cuites au four. Chaque
promeneur dispose d'une vingtaine de plaques sommaires qui préfigurent
une bibliothèque pauvre, rustique et essentielle : les ouvrages d'une
page évoquent les tablettes de buis chères à Pascal Quignard et à Simon
du Désert. Un ermite cultivé met à disposition son maigre butin pour le
pèlerin.
Un peu plus haut, dans la forêt, une sylphide au nom de scrabble Boucl
a monté un cadre, une portion de carré en voulant utiliser des
baguettes de noisetier écorchées faisant écho à la dentelle de la
vallée. L'artiste dit que «la flore est une seconde peau pour la Terre,
comme un motif textile posé sur sa surface.»
Mais le travail le plus convaincant reste celui du napolitain Luciano
di Rosa qui a concocté deux Heureux présages de haute volée par la
franchise de la proposition et la radicalité rieuse du binôme réalisé
en Italie au bord de la retenue d'eau de Castelo, une cocotte en papier
représentant un bateau repose sur la grève, l'astucieux pliage recèle
en italien un texte d'Aldous Huxley «Le meilleur des mondes», la page
échouée d'un texte précurseur sur une sculpture métallique de 2,50 x 75
cm de haut est signifiante.
L'avion de papier de 3 m de haut et de 1,20 m d'envergure planté dans
le sol vient compléter la partition. L. di Rosa dit que ce sont «des
objets qui viennent de loin» et il insiste avec Gorge Orwell qui
dénonce dans 1984 la concentration du pouvoir exercé par la classe
dirigeante.
Si l'on regarde les autres réalisations de ce plasticien prometteur né
en 1978 : un paquet cadeau de 1,50 m qui ne devait s'ouvrir qu'en 2012
et que la dureté de l'hiver a molesté, un code barre fait avec des
écorces en 2008 et restauré chaque année ainsi qu'un lance-pierres
géant qui vise un îlot au lointain, nous avons là un artiste costaud
qui se lève. Les objets qui arrivent de loin arrivent de l'enfance, ils
en ont la grâce et la majesté, dérisoires fétiches de l'imagination et
joyaux qui changent la lumière.
E.L.
Sentier Arte e Natura (SAN) - Année 1
www.sentier-san.eu
Association Grandeur Nature
Tél. : 06 99 52 55 05
info@festivalgrandeurnature.com
www.festivalgrandeurnature.com
Festival SENTIER ARTE E NATURA
- Queyras et Piémont - été 2010
|
SOMMAIRE
ART-O-RAMA & Vacances
Bleues - Show room - Boris Chouvellon
 Boris Chouvellon, «Petites victoires, petites morts»,
trophées, lit, 2010
Boris Chouvellon, «Petites victoires, petites morts»,
trophées, lit, 2010
Acquisition de la Fondation d'entreprise Vacances Bleues dans le cadre
d'ART-O-RAMA 2010 - Photo B. Muntaner
Copyright Fondation d'entreprise Vacances Bleues
Les
couleurs de l'absurde et de la dérision !
par Bernard Muntaner
En entrant dans l'espace
d'ART-O-RAMA(1) nous sommes accueillis par un grand lit à baldaquin
dont les colonnes sont constituées de coupes de pacotilles superposées
qui encadrent un lit recouvert d'un dessus rouge passion sur lequel se
prélassent quatre coussins enchevêtrés. Métaphores des corps enlacés,
passés et à venir ? Réceptacle de fantasmes érotiques ? Les colonnes
sont disposées aux quatre coins du lit, chacune est constituée de
coupes en plastique argenté ou doré, de celles que l'on remet aux
vainqueurs de compétitions sans prétention, entre clubs de quartiers
lors des dimanches sportifs, et qui peuvent faire rêver quand elles
sont alignées sur une étagère. Ces coupes sont renversées, l'une sur
l'autre, cul par dessus tête pourrait-on dire ici, dans un systématique
tête à queue. On dit bien «ériger une colonne». La colonne, comme tout
ce qui se dresse, est une érection. En ajoutant à chaque extrémité un
miroir, l'artiste en fait une colonne sans fin visuelle, qui laisse
augurer de l'infini abyssal d'une érection, ce qui, déjà dans le
concept, mérite un trophée ! On aura compris que les coupes ici
honoreraient les meilleurs résultats, les grandes performances lors de
manifestations érotiques et sexuelles pratiquées au lit. Le titre de
l'œuvre de Boris Chouvellon, Petites victoires,
petites morts confirme bien la notion de jouissance dans l'expression
«petites morts», quant à «petites victoires», elle souligne le côté
dérisoire et ironique de ce que serait la «victoire» dans le lit d'Eros
! Chacun a son champion ou sa championne... C'est un jeu où il n'y a
pas de règles, pas de départ, pas d'arrivée, pas de concurrence. Que
veut dire pour chacun la performance au lit, et en plus d'y battre un
record ? Qui en serait le vainqueur ? Dans son propre champ de
pratiques, on peut hiérarchiser ses expériences savoureuses, voire
exceptionnelles, mais que valent-elles en regard de celles de nos
nombreux voisins ? Alors la dimension dérisoire, ironique, et, pour
tout dire absurde, nous apparaît dans cette œuvre, car il n'y a pas de
référent univoque dans ce type de "compétition" amoureuse et/ou
sexuelle... Même si on parle vulgairement de "sport en chambre", il
semble que ce jeu se situe plus dans un espace sensible, entre la
prégnance du désir et l'aboutissement du plaisir, que dans la
gymnastique à deux. C'est de l'ordre de l'expérience, ce qui, par
essence, ne peut se transmettre, qu'elle soit liée à l'ancien
Kamasoutra, ou à des pratiques plus contemporaines, ou non. Le fait
d'attribuer autant de coupes-trophées dans le lieu même de la chambre,
nous "chambre"... Ces trophées voudraient titiller notre narcissisme,
notre supériorité (et uniquement celle du mâle ?) ; allongé sur le lit,
on voit son propre reflet se multiplier sur les formes convexes des
coupes, et on se dit «je suis le vainqueur, j'ai eu la coupe, et même
plusieurs, j'en suis même entouré...!» Mais trop, c'est trop. Il y a
loin de la coupe aux lèvres !... L'humour kitsch agit alors pour
souligner la dérision de notre dimension humaine : la vanité, la bêtise
de la prétention, et nous invite à un grand éclat de rire. La seule
coupe qui vaille ici, c'est celle que l'on peut boire jusqu'à la lie.
La dimension de dérision et d'absurde semble être un point de vue
privilégié chez Boris Chouvellon. À côté de cette œuvre, dont le projet
a été mécéné par la Fondation Vacances Bleues(2) à
Marseille, l'artiste a présenté également une vidéo qui le montre,
marchant en dessous d'une ligne d'horizon, sur une digue en béton où se
trouvent deux grilles de chantier qu'il déplace l'une après l'autre et
à la suite, créant un simulacre de frontière entre cette jetée et la
mer. On aura remarqué que la hauteur de la barrière est égale à la
hauteur qui se donne à voir entre le haut de la digue et la ligne de
l'horizon. La mer derrière une grille, un mur ajouré : protection de
quoi ? Quels enjeux ? L'artiste est à l'œuvre, tel un Sisyphe
horizontal dans cette vidéo montée en boucle, et donc sans fin encore,
et qui pourrait convoquer l'écho d'un Buster Keaton, d'un Samuel
Beckett ou d'un Philippe Ramette plus contemporain. Faire les choses
pour rien ! Pour le jeu. «Je sais que c'est stupide, mais je le fais
quand même». L'esthétique du gratuit et du non-sens. Aller jusqu'au
bout pour le plaisir de l'insensé. Mais c'est mettre aussi beaucoup de
sens que de jouer avec ce qui n'en a pas... à première vue.
 Boris Chouvellon, Sans titre, Série, Photographies
contrecollées sur Dibon, encadrées, 1,2x1,8m
Boris Chouvellon, Sans titre, Série, Photographies
contrecollées sur Dibon, encadrées, 1,2x1,8m
Courtesy de l'artiste
Enfin, sur la paroi extérieure
du stand, trois photos de drapeaux
attirent notre attention. Nous sommes dans un même rapport de stupide
vanité que dans les œuvres précédentes. Chaque drapeau est vu d'en bas,
photographié en contre plongé. On lève toujours la tête pour admirer,
c'est plus grand que soi, on est dans un espace dominé. Le drapeau, on
le voit de loin, c'est l'emblème d'un pays, ce qui réunit un peuple :
«servir sous les drapeaux», «la levée du drapeau», «l'hymne au
drapeau»,... etc. C'est le symbole d'une nation. Il est le signe de
ralliement dans le tableau La liberté guidant le peuple
de Delacroix. Il est sacré ! Au point que, symboliquement encore, quand
on veut avilir l'ennemi, on brûle son drapeau sur la place publique. Et
de même ici, ces hampes ne soutiennent qu'un fantôme de drapeau, un
squelette desquamé, un délitement du symbole, une mort annoncée et
entreprise de sa dimension sémantique : une disparition naturelle que
le temps et les intempéries ont réussi à user, au point d'en rendre
certains peu reconnaissables. Perte du sens. La nature reprend ses
droits, use et abolit visuellement les signifiés de l'étendard que
l'homme a voulu créer de façon durable, voire impérissable ! L'homme et
la nature se rencontrent ici, le combat de toujours se trouve illustré
dans cette opposition qui souligne encore la dimension vaniteuse et
absurde de nos images, comme le disait déjà Pascal. La prétention est
de ce monde, mais la dérision aussi. Alors : Gloire à l'absurde,
hissons les couleurs de la dérision !
B.M.
Octobre 2010
(1) ART-O-RAMA, Salon d'art
contemporain, du 10 au 12 septembre 2010
La Cartonnerie - Friche la Belle de Mai à Marseille
(2) Pour la deuxième année consécutive, la Fondation
d'Entreprise Vacances Bleues s'est associée au show room
d'ART-O-RAMA, en passant commande à Boris Chouvellon, pour la création
d'une œuvre qui viendra compléter sa collection et sera exposée dans
l'un des nombreux établissements hôteliers de la société.
www.art-o-rama.fr
ART-O-RAMA & Vacances
Bleues - Show room - Boris Chouvellon
|
SOMMAIRE
P A Y S A G E S C H A V I R E S
 Caroline Le Méhauté au domaine de Grand Boise,
«négociation 24 - être là», polyuréthane extrudé, résine, plexiglas,
60x700x10 cm
Caroline Le Méhauté au domaine de Grand Boise,
«négociation 24 - être là», polyuréthane extrudé, résine, plexiglas,
60x700x10 cm
P A Y S A G E S C H A V I R E S
par Emmanuel LOI
L'art est une pratique ruineuse
qui peut rapporter gros. En parvenant à isoler les phénomènes de
bruitage et d'encrassement des synergies dont nous voyons à longueur
d'exhibitions dans des lieux mal identifiés ou surcodés la ribambelle
fanée des déceptions encouragées, on peut gagner un peu de place. Se
sentir parfois un peu moins amer, revenu de tout.
L'entreprise menée par l'association Voyons voir dans un projet de
partenariat avec des domaines viticoles où les artistes reçus en
résidence sont invités à exposer sur le site de production a gagné
année après année de l'ampleur. A l'initiative de Bernadette
Clot-Goudard qui avait déjà montré son talent et son goût affirmés à la
tête du centre d'art contemporain d'Istres, des plasticiens montrent
cette année dans les exploitations partenaires les travaux de Nicolas
Desplats, Caroline Le Méhauté, Fabien Lerat et Boris Chouvellon.
La prise en compte de l'espace d'exposition à ciel ouvert n'est pas une
mince affaire. La question du sertissement dans un cadre établi, le
périmètre clos d'une galerie ( quelles que soient les dimensions) pose
la problématique du point de vue dans toute son excentricité : quelle
est la distance idéale pour saisir une œuvre, que l'alentour ne soit
pas déférent ou outrageux, comment se camper dans un face à face en
plein champ, en pleine vigne, avec une œuvre qui en général n'en
demande pas tant ? Exposer dehors, au su de tous - même s'il faut faire
quarante bornes pour dénicher la perle rare et siffler un petit nectar
- souligne le détournement, appelle l'appropriation et suppose d'éviter
la controverse entre adaptation et acclimatation entre la sacralisation
de l'écrin (un lieu fait pour) et l'édification païenne de la borne, du
totem, du menhir ou de la stèle hors décor.
Dans une biologie de l'art, nous pouvons voir que la force d'une
proposition provient en grande part non seulement de son impact sur le
regard convié du passant ou amateur mais aussi de la percussion en
retour sur son auteur, tel le recul d'une arme. L'adaptation à une
technique, à un lieu, à une tradition, facilite le travail ; le
processus d'aménagement de l'outil à la performance est une nécessité
et un permis de voir. Volontaire ou subi, ce mouvement de translation
et de conversion invite à correspondre, à trouver des correspondances
entre l'objet dépareillé, sorti de son contexte et de son acceptation
courante et la production outillée d'un sujet non reproductible, de la
pièce, du morceau célébré. L'acclimatation -comme le Jardin du même
nom- est toute autre chose. Elle implique une gouvernance commune entre
l'instinct et la coutume, entre l'obstination à se reproduire de la
part de tout ce qui est vivant et le besoin de donner le change.
L'exposition de plein air, la dépose temporaire dans des lieux
inadaptés, enclos dans des jardins et espaces privés à destination
précise ou sur invitation, se différencie de l'installation plus ou
moins pérenne de la commande publique, commémorative ou non. Elle est
factuelle, ingénieuse et occasionnelle. Venir visiter une œuvre dans un
lieu où il n'y a de passants que conviés fait penser au privilège du
grand seigneur qui, dans l'enceinte de son château ou de sa villa
romaine, recèle quelques pièces transformées en vestiges afin d'attiser
la convoitise et asseoir sa magnificence.
En dépit de ses embûches - distance, isolement, signalétique
incertaine, action doublonnée de promotion des caves, cuvées de jeunes
artistes, label promenade et écotourisme culturel - la proposition de
Voyons voir fonctionne avec pas mal d'allégresse. L'écueil du
sponsoring lourd est évité, Ricard et Caisse d'Epargne n'apparaissent
pas, la manifestation sait rester modeste et pointue.
Quatre artistes montrés à Grand Boise valent le détour. L'art est une
pratique druidique, si l'on en croit nos yeux, si l'on se fie à ses
yeux, si l'on accepte d'être excentré. Nicolas Desplats a construit
sous forme de panneau publicitaire qui macule l'entrée de la plupart de
nos agglomérations un photogramme panoramique du point de vue. Thème
double de la duplicité barré et souligné d'un RIEN NAIT A SA PLACE, la
planche-contact d'une partie de réel est agrandie. On y voit et est
représentée la vallée de Puyloubier et Pourrières qui marque les
contreforts de la Sainte Victoire.
Montage subtil qui déroge à la perception binoculaire classique. Incité
à lire le paysage, à décrypter le message-slogan, le pèlerin
s'interroge sur le mystère jubilatoire du surlignage (commentaire,
dédiscalie, incantation). En effet, quelle est la place de la naissance
du regard, d'où je vois ? puis-je avoir été là et mesurer la migration
? Focus sur le cheminement, la déambulation et la perspective.
Peintre des monts et du cadrage de la montagne, Desplats a serti là un
sécatif, chaque explorateur éprouve au sommet d'une butte ce sentiment
sur une crête dominant la jungle. Incitation au voyage sur place,
occasion de dérive. Lui reste à parcourir ce qu'il a déjà effectué, il
ne peut nullement simuler l'effort par une transaction psychique : tout
se ressemble, tout se répète et il faut pourtant y aller. Le lieu de
naissance du plaisir est-il pile poil lieu de la naissance du regard ?
Caroline Le Méhauté a pris possession de l'étang et a aussi paraphé
l'espace au dam de certains qui ont jugé que la nature se passe de mots
et n'a nul besoin d'être illustrée. Cette accusation de calcul
pernicieux, de surcharge, n'est pas vain et mérite débat. Au milieu
d'un étang en forme de cœur, l'artiste a disposé parmi les ajoncs
quatre lettres en polystyrène de 80 cm de haut, les a lesté et relié
entre elles de sorte qu'elles puissent pivoter selon l'alizé. Les
quatre lettres R, I, E, N, anagramme de Nier et de Rein, ne se
mélangent pas et obéissent à la caresse du vent. L'effet de surprise
est réussi quand, arrivé au sommet d'une colline, nous découvrons la
pièce montée sybilline.
RIEN au milieu de la nature, au milieu de l'eau. Que l'allitération
soit un geste de prédation, rien n'est moins sûr. La nature a-t-elle
une probité avant que l'on y soit, avant le regard porté sur elle ?
Resucée rousseauiste, hymne du poète à l'état d'immanence vécu comme
pureté. Cet étang, créé et aménagé par la main de l'homme, supporte une
intervention et l'appelle. Pour paraphraser Devos, rien ce n'est pas
rien du tout. Un étang, ce n'est pas rien. Etang alangui, eau dormante,
lieu de concert, anse de la mélancolie (Ophélie, Virginia Woolf et
autre Mélusine). L'étant comme lieu de l'être. Par cette stance,
Caroline le Méhauté a franchi une étape, son travail antérieur d'une
belle finesse laissait présager cette avancée. L'évocation par peu de
moyens, à portée de voix, la mise en garde du silence. Faire payer aux
mots leur tribut et refuser la compromission du discours. Beau souffle
présocratique.
Les autres travaux sont d'une autre facture à l'ellipse moins réussie.
Fabien Lerat a créé un miroir-écran qui fait face à la Sainte Victoire,
l'idée de cadre appelant et réfléchissant une image surconnotée, la
masse de la montagne Sainte Victoire, produit un écho assez plat,
plutôt scolaire ; le cinéma de la représentation, l'abus de l'emblème,
le registre de la carte postale et du cliché intégré et exportable est
traité sans trop de perspicacité ; le renvoi à l'histoire de l'art en
tant que clin d'œil, que clapet alternatif de l'entendement ne prodigue
pas de saisissement. Exercice terrien qui approche et épelle la mémoire
d'un site mille fois fléché sans vraiment le déjouer, faire jouer les
mécanismes d'identification, de reconnaissance, de simulation. Le grand
miroir et son belvédère restent statiques ; couvert d'un fin fil
opaque, la vue imprenable prise dans un jeu de ping-pong étouffe, la
correspondance est trop vite établie entre la jouissance du regard et
son assoupissement dans le codex. Entrebâillement académique, le
vouloir dire, le vouloir montrer sont mis en avant et ne peuvent
progresser par un accident, une désinence, un saut. Sorte de mirage
éteint, cette installation laborieuse ne stimule ni l'œil ni les
synapses.
Par contre, la dernière proposition de Boris Chouvellon paraît beaucoup
plus costaude et alerte. Il a conçu et monté une piscine de béton
carrelée à l'emporte-pièce, à la verticale. Travail lourd, épais,
hyperconcret. Evoquant la série de menhirs moulés érigés à la gloire du
crédit qui polluent les arrière-pays ensoleillés, l'artiste trentenaire
frais émoulu de son art du contrepoint dénonce avec force la mainmise
de gadgets lourds dans l'environnement ; il ne fait pas dans la
dentelle, le mausolée destroy qu'il a édifié dans le domaine de Grand
Boise persiste à être grotesque, un emblème farouche du mauvais goût,
du presque riche qui s'extasie à barboter dans une bassine en
plastique. De Montélimar à Menton, ce genre de pustules pullule,
piscines en plastique moulé bleu. La stèle, par sa monstruosité
pataude, déjà ruine, cingle le préjugé. La peau du luxe en kit. Laissé
en chantier au gros œuvre, le monument à détruire suscite un parallèle
avec la défection de la beauté du bassin d'eau douce datant du XVIIIème
siècle ou de la retenue d'eau, du coude d'eau rêveur. Chant sépulcral
de la vergogne, un beau tempérament d'artiste, quelqu'un qui ne fait
pas dans le futile, dans le coloriage. Ou l'association d'idées à
quatre balles. Construire une ruine est bien sûr métaphorique.
Ce type d'initiative entrepris par l'association Voyons voir montre
qu'il est possible de déspatialiser le champ culturel de l'exposition.
L'art à la campagne, sans être du land art ou de l'art floral. La
déroute du confinement doit être encouragée. L'art in situ en tant que
pratique festive.
E.L.
Du vignoble au jardin
28 mai- 29 août 2010
Domaine Château Grand Boise
Chemin de Grisole, 13530 Trets
Voyons voir art contemporain et territoire
www.voyonsvoir.org
P A Y S A G E S C H A V I R E S
|
SOMMAIRE
UN JOURNAL DE LODÈVE 2010
 Vernissage de l'exposition Calligrammes, Photo
Montagne Froide
Vernissage de l'exposition Calligrammes, Photo
Montagne Froide
Festival de Poésie
Voix de la Méditerranée
du 17 au 25 juillet 2010
13ème édition
par Nadine Agostini
Samedi 17 juillet
Avec Jean-François Meyer et Marina Mars. Arrivés à Lodève. Appartement
cœur de ville.
19h00 - Discours d'ouverture. «Les
Voix, grand moment de fraternité.» Marc Delouze «Il y a
treize ans, impression de lancer une grande bouteille de champagne.
Immense plaisir aussi d'accueillir Bernard Noël pour ses 80 ans. Et
Armand Gatti. Et Henri Deluy.» J.Blaine «Depuis cinquante ans je me dis
: ce que nous faisons, poètes, est parfaitement inutile. Et quand on
voit ce qu'ont fait les enfants, non, pas inutile. Place aux jeunes et
aux nouvelles formes de poésie.» Une anthologie regroupant des textes
des auteurs invités vient de paraître.
21h00 - Soirée d'ouverture. Les
Méditerranéennes. 13 femmes poètes et des musiciens. Voix
multiples langue d'origine et traduction. Accordéon guitare percussions
violon vielle saz.
 Michel Collet - Photo Montagne Froide
Michel Collet - Photo Montagne Froide
Dimanche 18 juillet
12h30 - Alarme. Alarme. Serge Pey et Chiara
Mulas. Sirène et mégaphone. Poème de négociation.
Grand étendage textes / dessins oiseaux / photos / encrages / points
d'interrogation et mouvement poisson. «à la main comment veux-tu...
alors on se moque de moi...» Chamanique ou rupestre ? «Si j'ai un
bâillon sur la bouche / comment veux-tu que je te parle / pour dire que
j'ai justement / un bâillon sur la bouche ?»
Déjeuner dans la cour de l'école. Blabla avec Jean-Charles Depaule.
- Quel est le rôle qui t'a été confié dans cette 13ème
édition du festival de Lodève ?
- Celui de présenter des rencontres brèves sous le signe de la
dégustation de vin dans un lieu dédié à l'art et au vin. Ce matin il y
avait une très grande qualité d'écoute. Plein à craquer.
16h00 - Jean-François Meyer présente le
festival Poésie-Marseille. Cette année, ce sera le
7ème anniversaire. Le festival s'ouvrira sur la poésie du monde arabe.
18h00 - Vernissage de l'expo Calligrammes
(XIX, XX et XXIème siècles) qui a pour support un catalogue de 500
pages, calligrammes, compagnie & cetera
paru récemment aux éditions Al Dante.
21h00 - Action Poétique Anniversaire. N° 200.
Maxime Pascal lit quelque chose sur les oiseaux. J-C Depaule lit A la
prose. «...jetées de fleurs... virgulette... ciseau de jambes nues en
l'air... tradition et récit... grenouille à peau de concombre... la
bière n'a pas le même goût...» Claude Favre «... sanglier...s'ébrouer
de bruits de verre... mastique d'espoir... pupilles muettes et
plonger... j» Henri Deluy «... et puis la courbe séchée des noms sur la
colline... ce qui s'ajoute s'éloigne... deux couteaux se partagent la
plaie...» Liliane Giraudon la fin d'un portrait d'Antonin Artaud «...
les couleurs des petits cahiers... les tubulures les croix... la notion
de grumeaux chez Artaud... il faut regarder ce dessin encore une fois
après l'avoir vu une fois... Artaud et son interne écartèlement de
l'être...» J. Blaine «... ce côté... est une façon d'écrire que
l'auteur n'a rien à dire... l'immortelle mort du monde... les histoires
sont simples c'est l'écriture qui les rend complexes... l'insecte n'est
pas allé loin...»
Fin de soirée. On mangera et on boira toujours dehors. Dans la
fraîcheur de la nuit.
 Edith Azam et Démosthène Agrafiotis - Photo Montagne
Froide
Edith Azam et Démosthène Agrafiotis - Photo Montagne
Froide
Lundi 19 juillet
Marché aux livres. Stand Fidel Anthelme X. Frédérique Guetat-Liviani et
Dominique Cerf.
18h30 - Frédéric Nevchehirlian en poète
désincarné. Michel Collet la femme de lettres et le lé le lez le lait.
La femme de l'être ? L'affame de lettres ?
19h30 - Projection du film de Jacques-Henri
Michot Terre ingrate, mais pas totalement. Il montre qu'ailleurs aussi
des travailleurs manifestent, se rebellent, que les esclaves ne veulent
pas mourir de faim, qu'ils veulent être des hommes dignes et respectés.
21h00 - Compagnie Alzhar.
Rimbaud Tarkos Artaud Char Cendrars Quintane Desheng Césaire Mallarmé
etc. Un comédien une comédienne. De beaux moments.
22h30 - Projection J. Blaine, l'éléphant
et la chute. Ce qui m'intéresse dans ce film de Marie
Poitevin, c'est l'interrogation de la fille. Sa place à elle. Et les
questions qu'elle se pose sur ce père, cet homme, qui intervient /
écrit sous un pseudonyme. Si forte la présence / l'absence de cet
homme.
 Fabrice Caravaca et J. Blaine - Photo Bruno Guiot
Fabrice Caravaca et J. Blaine - Photo Bruno Guiot
Mardi 20 juillet
M. Collet et Valentine Verhaghe sont Montagne Froide.
Ils font aussi une revue. mobile.
11h30 - Michèle Métail. Axe Berlin / Pékin.
Odeur de l'encre de Chine. Chine ancienne. Traduction. Déclenchement
mort de Pérec. Livre. Langue chinoise permet à l'infini de faire des
palindromes. J'ai trouvé des textes du IIème siècle qui sont
extrêmement modernes. J'avais vingt-deux ans quand je suis entrée à
l'Oulipo. Le rêve de Queneau était d'inventer de nouvelles formes
fixes. Depuis 98 je travaille sur la lettre X, travail de longue
haleine.
12h30 - Giovanni Fontana. Ça roule et coule et
ça vrombit ça s'énergise ça monte et ça descend et boum ça rebondit.
16h00 - Lecture croisée. Florence P. L'inadéquat
le lancer de dé. «...attendu que... ce cœur superficie... ne
se nomme pas rien... est impropriété... insitué... annule le hasard...»
Les élèves de l'atelier lisent les textes qu'ils ont écrits.
17h00 - Rencontre radiophonique en public.
- Michel Collet vous travaillez sur le sens des mots et le son. Nous
allons écouter un extrait de votre travail sonore. La communion des
saints.
- Je travaille là-dessus. Ici avec Joachim Montessuis.
- Est-ce que, selon vous, la poésie urbaine a sa place dans la poésie ?
- Il y a de multiples aspects de la poésie... pluralité des voix.
Entretien perso avec Michel Collet.
- Pourquoi Montagne Froide ? C'est quoi ?
- C'est la traduction Han Shan, un poète du IXème siècle, qui regardait
le monde en souriant. 1989. Anniversaire de la révolution française. On
était en Chine. C'est un collectif à géométrie variable qui travaille
sur des projets avec des gens qui viennent d'autres disciplines. Nous
avons fait cette structure pour créer des évènements, des éditions et
exister face à des interlocuteurs comme par exemple les institutions.
19h00 - Stand Fidel Anthelme X.
J. Blaine lit Tchakapech. Démosthène Agrafiotis arrive de Chine.
21h30 - Le Neuf. Plein à
craquer. Edith Azam se donne à fond. Trois écritures différentes.
22h00 - Pep Aymerich. Le corps / le feu. Parti
du sol le front / recroquevillé le corps. Parti du sol le front s'élève
tandis que brûle le double. Et puis images. Le double et soi courent
sur l'eau à se rejoindre. Et puis le double que soi maltraite. Où est
le je ?
22h30 - Trio Sandrine Gironde (voix / écho et
respiration) Franck Doyen (texte comme journal de bord / journal de
mer) Fabrikdelabeslot (sons de l'eau et des cordes pincées).
 Giovani Fontana - Photo Montagne Froide
Giovani Fontana - Photo Montagne Froide
Mercredi 21 juillet
10h00 - Film de F. Pazzottu. Interroge Alain
Badiou sur la poésie le poète dans / sa place dans la société / dans le
devenir. Et des habitants. Marseille qui change de visage. Les pauvres
qu'on chasse de leurs quartiers pour refaire appartements qui se
vendront cher.
15h00 - Lecture au gré de l'onde. Harold
Shimmel. Pourquoi traduisent-ils "holocauste" quand il dit "lamb" ?
Même si c'est le mot il a ce mot une résonance autre.
18h00 - Rencontres radiophoniques en public.
Lectures et entretiens ponctués par le musicien Mahmut Demir. Mohamed
Bennis (Maroc).
- Pourquoi votre besoin de faire connaître la poésie
arabe ?
- Porteuse de toute une civilisation. Poésie antéislamique. Notre part
de l'antiquité. Manière de vivre et de sentir. Présence du corps, de
l'intériorité et de l'extériorité. Ce qui m'intéresse, c'est la poésie
elle-même, la parole poétique, de quelque langue qu'elle soit. Nous
vivons dans un monde où elle est menacée. L'année dernière, j'ai
traduit Bataille en arabe. A Lodève on se sent bien. Les poètes invités
sont d'une grande qualité.
Lilane Giraudon lit extrait de La Poétesse. «...
trois petites figues vertes... a pensé... le savon... venait sans doute
de sa jeune maîtresse juive... mais où va le cœur ? à qui est-il
?...c'est ce qu'a écrit la poète à Alger... la canicule dont le nom
vient d'une étoile portant le nom d'un chien... je dois essuyer un
féminin terrible...»
- Etes-vous d'accord avec la notion de maladie définie
par Mohamed Bennis ?
- Cette maladie elle ne concerne peut-être pas les habitants de ces
deux portions de la Méditerranée... On oublie qu'il y a des frontières
avec des papiers... la maladie est dans le quadrillage des territoires.
18h30 - C'est papou / c'est pape / c'est pas
pourri / c'est pas pour rien. Ah merde ! Je déconne. Je ne suis pas la
réincarnation de Ghérasim Luca.. Bon ben en tout les cas c'est pas pour
rien que je suis revenue à la Halle. C'est plein la terrasse du bar
elle s'expanse. M. Métail dans le verbe et dans l'assiez comme elle est
belle qui murmure et qui monte la voix / le son de la voix et nous fait
rire. Et puis G. Fontana le revoilà puissante et caressante sa voix qui
nous fait rire aussi (non les poètes ne sont pas des clowns) et qui
vous pousse à la joie. Mais pleure-t-il ? c'est eux c'est elle et lui
les mètres les vrais qui donnent la mesure et qui travaillent sans
relâche au texte.
Arrive Fabrice Caravaca (poète et éditeur du Dernier
Télégramme). Loge chez moi.
21h30 - Sylvain Courtoux et Emmanuel Rabu qui
parodient qui se plaignent en chantant des non-réponses des éditeurs
qui publient pas / qui répondent pas / de la vie et mort d'un
poète de merde.
 Joan Casellas bâillonné par Nadine Agostini, Photo
Montagne Froide
Joan Casellas bâillonné par Nadine Agostini, Photo
Montagne Froide
Jeudi 22 juillet
Déjà jeudi. Je n'entendrai jamais Bernard Noël. Il intervient en fin de
matinée lorsque je fais chauffer de l'eau pour le café lorsque je suis
dans la perte du langage et à sa recherche (du langage).
12h30 - Joan Casellas performe. Il sourit tout
le temps. Il compte. Il compte. Il compte. Il recompte.
- Je le fais arrêter Démosthène ?
- Vas-y .
17h00 - Les pieds dans l'eau. Manal Al Sheikh
poétesse iranienne. Dans ses derniers poèmes se mêlent la lumière de
l'Irak et celle de la Norvège. Elle a une belle voix. Erotisme interdit
en ailleurs. «...Egon n'a pas peint avec le sang des menstrues sur la
céramique de la salle de bains...»
Olivier Domerg. «... des formes et des franges se font jour... je vois
entends le... qui racle et creuse durement... faisant blêmir l'océan...
dans la naïveté de tout récit... une écume écrue et sale... houle
ourlets roulants et colère...»
18h30 - Serge Pey. Lit QUA.
Il ne lit pas il est il devient il coule son visage goutte et mouille
et pleut sur le livre. QUA QUA tandis que son poing
droit tape inlassablement sur la table son poing droit fermé le côté
droit du poing devient bâton / tambour et pierre sur le sol qui lui
rythme la voix / le débit ou bien l'un l'autre la voix rythme le poing
il est là je le retrouve qui au tout début inspira l'écriture. +
tomates / élastique.
20h00 - HP Process.
Philippe Boisnard et Hortense Gauthier chacun son ordinateur et des
trucs scotchés aux poignets et des pinces au bout des doigts et les
doigts tapent sur le clavier le texte qui apparaît au mur 2 écrans et 2
couleurs le rouge et le blanc sur le noir ou le rouge et le noir sur le
blanc je ne sais pas ça va très vite les écritures se croisent et au
dedans les voix et les respirations ils improvisent une rencontre
virtuelle les visages apparaissent sur les murs elle en grand en
vignettes le son les voix le texte se mêlent la rencontre amoureuse lui
comme spectre les lunettes et la bouche comme elle visage découvert lui
caché comme loin proche elle se lève harnachée de câbles elle tient la
caméra sur elle sur sa peau et le son de lui de sa voix à lui qui
s'amplifie qui vient vers elle qui vient vers lui la peau elle se
désir-habille se déshabille il veut la voir elle est couchée sur le dos
au sol la caméra se promène sur sa peau elle promène la caméra elle /
mon œil va des écrans petits aux murs aux doigts aux poignets qui se
lèvent et modulent la voix et font danser le texte et tournoyer aussi
et des écrans à elle en chair et en os sortie de l'écran et pourtant
dessus et / et alors c'est ça c'est ça la rencontre cette fille elle
est belle a une plastique magnifique surtout c'est surtout sa peau qui
se lève et se plaque sur l'écran on ne sait plus lequel le sien à elle
/ à lui en croix elle est en croix de dos le corps plaqué contre
l'écran le mur en croix le corps et lui il / et lui il est si ébloui
qu'il en
Vendredi 23 juillet
12h30 - G. Fontana. Texte Maori. TristAn
Dzaara j'entends. Giovanni une demi-heure le texte il le tord comme on
veut.
- Comme un percolateur Giovanni !
16h00 - Présentation d'Expoésie.
Edith Azam et son Mercure. A la fin Hervé Brunaux
et son texte en mouvement perpétuel sur les poètes et Bruno Guiot qui
écrit les noms des poètes présents sur un petit tableau. Les noms se
chevauchent sur le tableau sur la craie / les poètes nous jetons des
tomates. H. Gauthier décline des titres de thèses. Laurent Besse casse
à la masse une grosse pierre à coups de masse. F. Doyen /
Fabrikdelabelost / S. Gironde. C. Favre les marins la Bretagne. F.
Caravaca se joue de ses compères et pères. Je donne à consulter. J.
Blaine la longue marche. On boit du Bergerac amené
par les périgourdins.
18h30 - Jeryes Samawi, Jordanien, poèmes à
deux sens deux écoutes. Sourates de l'eau. Ensuite Olivier et moi et
son bon texte sur Maurice Roche Maître en pièce(s).
Grand succès.
21h00 - Joachim Montessuis performe le texte
le son sa voix SES voix et les gens bouchent leurs oreilles et pourquoi
ils se les bouchent les oreilles ? Quand les pères hurlent dans les
micros ils ne les bouchent pas leurs oreilles. Pourquoi les gens ils
n'écoutent pas ils n'entendent pas le texte ? Et puis son film La
danse des fous. Roto-reliefs de Duchamp visage de Valentine
V. comme Nijinski Michel Giroud en fou J. Blaine la langue et Joël
Hubaut la cagoule les croix les morceaux de tableaux en patchwork sur
la gueule.
 Nadine Agostini, Photo B. Fichet
Nadine Agostini, Photo B. Fichet
Samedi 24 juillet
Encore raté ce matin film de Chiara Mulas et hier sa performance quand
je lisais avec Olivier. Ici, l'expression «On ne peut pas être au four
(elle découpait l'agneau, le farcissait) et au moulin (nous lisions
Olivier et moi en plein vent)» prend tout son sens.
12h30 - Démosthène vidéo et intervention.
L'eau. Les mains de lui sur l'écran animé. Le fil rouge avec lequel il
nous lie nous qui sommes assis à regarder nous qui le regardons.
15h00 - Réunion Amassada Rromani
Transversales. Projet né de la place des Rroms en France et en Europe.
Question d'identité à travers l'expérimental qui utilise
l'improvisation pour créer la rencontre. Ce qui est intéressant dans la
culture Rrom, c'est qu'elle est toujours transformée au contact des
autres cultures. Les Hongrois surtout ont utilisé la musique Rrom. Ce
soir, poètes improviseront ensemble. Comment on dit ?
- Avoir le droit de notre voix ?
- Oui.
17h30 - Départ du grand cortège depuis le
jardin de l'Hôtel de ville. Du bruit. Des cloches et puis des
instruments. Des machines. Des voix. Entraîner les passants sur les
berges de la Soulondre. Kujtim Pacàku récite et une femme lit les
traductions de ses poèmes. Ensuite on se met aux micros et les
musiciens à leurs baroques instruments et on y va. Le chourmo la
cacophonie dans mon oreille. Durant les discours précédant la lecture
et durant la lecture, j'ai pris des notes et me sers du petit dépliant
intitulé Qui sont les Rroms ? A partir de là et des
sons entendus que j'ai retranscris des poèmes de Kujtim (qui ne sont
peut-être pas les vrais mots pas les vrais sons qu'il a prononcés) je
cut up le texte composé en urgence avec les mots du poète dedans et les
sons retranscrits . Au micro donc tandis que Didier Calleja au micro en
même temps et Méryl Marchetti idem et à la fin le chourmo complet avec
Démosthène à la flûte mais pas de pan ce qui est le comble pour un
Grec. Les gens disent que c'est magnifique cette fin qu'on a faite.
Démosthène et moi remontons les rues. On a raté la performance de Serge
Pey et de Chiara Mulas avec les pastèques. On mange de la pastèque. On
est fatigués. On est bien là à écouter le récit de la performance. Le
soir D. Calleja danse debout sur une chaise. Il tournoie. Il monte sur
scène et y déploie une tente. Il fait d'une chaise un tambour.
Dimanche 25 juillet
Fabrice et moi quittons l'appartement. Il retourne à son stand. Je
rentre à la maison.
N.A.
Voix de la Méditerranée
13ème Festival de poésie
34700 Lodève
17-25 juillet 2010
www.voixdelamediterranee.com
UN JOURNAL DE LODÈVE 2010
|
SOMMAIRE
LE MACUMBA NIGHT CLUB expose
ZORA MANN Aux Ateliers SPADA
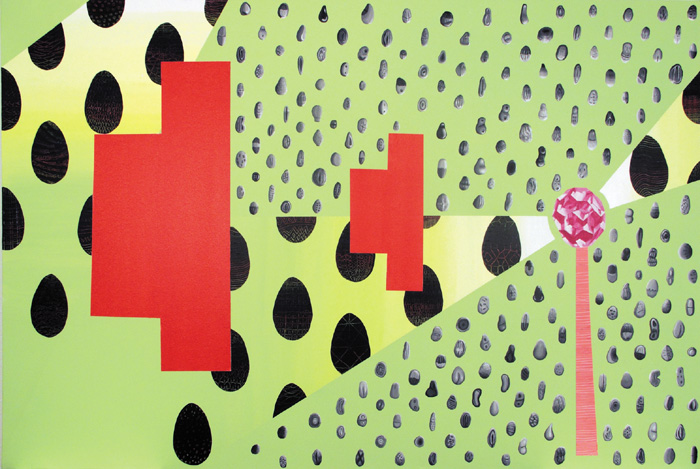 ZORA MANN
ZORA MANN
LE
MACUMBA NIGHT CLUB
expose ZORA MANN
par Cécile Mainardi
Energique et courageuse
initiative d'un des artistes-occupants des ateliers municipaux de Nice,
David Ancelin, que d'ouvrir l'espace de son atelier à un espace
d'exposition. Du jamais vu aux ateliers Spada. La division de son
atelier entre un espace de travail et un espace d'exposition,
intelligemment conçue et aménagée, propose là une logique de
décloisonnement des modes de monstration des œuvres, et je gage à la
clef quelque chose d'une ambiance singulière néo-tribale, qui devra
moins aux boîtes de nuit afro-cubaines qu'au fantasmatique respect
d'immémoriales pratiques cultuelles et magiques. Le Macumba Night Club,
puisque c'est ainsi que l'artiste l'a baptisé, se voudrait selon lui : «un
espace atelier-exposition qui accueille sans ligne de conduite ou
concept précis et sans budget, tout artiste ou pas, susceptible
d'investir le lieu. A cela se rajoute la production possible d'éditions
en sérigraphie...».
C'est l'artiste-peintre Zora Mann, elle-même occupante des ateliers
jusqu'à l'été dernier, qui étrennera le lieu par une exposition au
titre insolite et polysémique de «Growth Readiness» (=
ouverture/aptitude au développement), tout droit venu du jargon
économique des entreprises anglo saxones, mais ici detourné de son
emploi sectorial à des fins toutes secrètes et personnelles - comme si
Zora Mann sautait d'un champ à un autre, moins par ironie (je ne lui en
connais pas, et tant mieux) que par capacité magique à faire s'évaporer
le sens/tout sens figé. A croire qu'elle rejoue dans ce titre
l'opération même qu'elle réalise dans ses tableaux qui, à l'instar d'un
texte poétique, suggèrent que chacune de ses séquences est
aboutissement et commencement du processus signifiant, et est donc
essentiellement dynamique. Si le langage poétique, comme l'énonce
Kristeva, «est la seule pratique linguistique qui transgresse
la loi 0-1 ou, pour mieux dire, le découpage linéaire du signe en
signifiant-signifié», alors les tableaux de Zora sont à nul
doute aussi des poèmes. Il est toutefois question de développements
dans ces peintures semi-abstraites : développement organique (objets et
cellules y pullulent), développement du fantasme, développement des
surfaces et des motifs picturaux. Par exemple, la régulière
«ventilation» (qu'on pourrait prendre dans ses deux sens de répartition
dans l'espace et d'aération) de tel ou tel motif dans le tableau, que
ses bords tronquent et laissent dans un état de reproductibilité
supposée au-delà de la toile, nous plonge dans un univers continu ou
non-coupé. Cette peinture ne procède pas pour autant de l'abstraction
du pattern painting, car elle figure une vraie tranche/coupe d'univers,
vivant, autonome et autonomisé : un biotope (= ensemble d'éléments
caractérisant un milieu physico-chimique déterminé et uniforme qui
héberge une flore, fonge et une faune et des populations de bactéries
et autres microbes spécifiques) livré à l'imaginaire psychédélique de
l'artiste. On se trouve ainsi confronté à une forme de paysage dont
l'échelle échappe, vu comme au microscope fabuleux d'une science exo ou
endo-terrestre, à moins que ça ne soit au travers de lunettes qui
feraient soudain voir les objets non-localisables dans le temps ni
l'espace de la physique quantique), et dont on est bien conscient de
l'absolue non-répétibilité. Une chose, seule et unique a lieu,
non-prédictible, non répétable, et qui «change» l'air (comme on dit
«changer» l'eau) de l'image. Car l'air plus que la perspective - si
vous m'accordez ce volontaire zeugma - semble le milieu de subsistance,
de prolifération et développement de cette peinture. Oui, Zora change
l'air de l'image comme on change l'eau d'un aquarium.
 ...
...
@@@ Mes oreilles de poète font
que je ne peux pas m'empêcher de songer
aussi, par le biais d'une translation toute phonétique de l'anglais au
français, à quelque chose de la «grossesse» (< growth = grosse =
enceinte), et de voir dans ces faisceaux d'ovules et de grains un
principe ou agent de fécondation imaginaire en action. Tout comme au
nom de Fiona Rae (à la peinture de qui on ne peut pas ne pas penser
face à ces oeuvres), je lis et j'entends Rea...
Tout comme au nom de Zora, j'entends qui résonne la machine suffixale
«zoaire» :
anthozoaire, protozoaire, spermatozoaire !
Comme j'aime en parsemer certaines de mes articles, voici quelques vers
inspirés par ce travail
- Damier psychédélique pour jouer aux dames avec les messieurs.
- Vous avez des évanouissements éthérés-sexuels ou n'éternuez qu'à
genoux.
- La cerisaie s'emballe d'un coup d'un seul au niveau du col utérin.
- Bite en guimauve et sexe couleur bonbon haribo.
C.M.
LE MACUMBA NIGHT CLUB
ZORA MANN : Growth Readiness
le 19 novembre 2010
Aux Ateliers SPADA
(Ex-entrepôts SPADA)
22, bis avenue Denis Séméria, Nice
LE MACUMBA NIGHT CLUB expose
ZORA MANN Aux Ateliers SPADA
|
SOMMAIRE
VANESSA SANTULLO & Alii
 (c) Vanessa Santullo, & Alii
(c) Vanessa Santullo, & Alii
VANESSA
SANTULLO & Alii
par Beya Bentayeb
Comment l'être humain se place
t-il dans l'environnement ? Au sein de la société ? Qu'est-ce qui lie
les individus entre eux ? Le travail de Vanessa Santullo(1) interroge,
d'une manière générale, sur ce qui fait le lien entre les gens, ce qui
fait qu'on appartient à une communauté, à un groupe. Quelle que soit la
nature du lien qui nous unit, nous sommes tous inéluctablement reliés
les uns aux autres. Dans le cadre du festival «Les Littorales» autour
du thème "Moi et les autres", Vanessa Santullo présente, à la galerie
Agnès b., «& Alii» une exposition composée de photographies (Bande
à Part, 2010) et de vidéos (Les Autres, volet 1 et 2,
2003). Ces vidéos sont deux films, de 7 et 9 minutes, qui montrent
comment le mimétisme peut se mettre en place au sein des groupes, et
comment dans des groupes plus restreints (duo, trio) les individus
s'identifient et deviennent presque pareils dans la façon de bouger, de
se vêtir, dans l'attitude, dans la gestuelle, tout est dans les petits
détails. Mais on observe qu'il y en a toujours un ou deux qui vont à
contre-courant. L'artiste pose son regard et capture des fragments
d'humanité (des gens filmés ou photographiés) au hasard dans un
contexte urbain. Elle invite ainsi le visiteur à explorer la diversité
des liens, la rencontre avec l'autre, l'échange, les gestes, les
attitudes au sein d'un groupe et aussi à observer ce qui l'attrait et
la fascine ; les gens, ces Autres, que cette rétine humaniste observe
et capture avec beaucoup de poésie et de recul. Vanessa Santullo crée
ainsi un univers émotionnel qui, au-delà du questionnement
sur le lien et l'appartenance possible à une communauté d'individus,
souligne les attitudes et les postures corporelles de chacun.
Ces petites formes vidéo pourraient poser la question du «comment être
ensemble»? (2).
 (c) Vanessa Santullo, image prise à Rome intitulée
«Eternels»
(c) Vanessa Santullo, image prise à Rome intitulée
«Eternels»
La série des dix photographies
qui suit est comme son titre l'indique
«à part» car il ne s'agit pas d'une bande vidéo mais de photo. Celle-ci
commence par un triptyque poétique ; un morceau de bitume sur lequel
est inscrit «je veux une suite et pas une fin», une étoile rouge
dessinée sur un bras et un coucher de soleil (ou un arc-en-ciel) ; une
façon de regarder vers le ciel et la terre, de dire que nous ne sommes
que «poussières d'étoiles» (?) et que le monde qui nous entoure, la
nature et les signes, est aussi important que la relation que nous
avons à l'autre.
Sur cette photographie, on retrouve trois fois l'image de Rome. En
arrière plan, la ville, puis sur la plaque, représentant la vue d'en
face, et enfin sur le parapluie. De plus, on ne le distingue pas très
bien mais la jeune femme tient un appareil photo face à elle, elle est
sur le point de se prendre elle-même en photo, à moins qu'elle l'ait
déjà prise. Le geste de son compagnon nous laisse imaginer qu'il lui
propose de la prendre. Ce couple nous montre ici que l'individu reste
individu même au sein d'un groupe. Voici une image composée, une mise
en abîme sans aucune mise en scène, puisqu'elle a été prise sur le vif,
un certain dimanche à Rome par temps de pluie, une image qui interpelle
et raconte plusieurs histoires. Et là, encore il y a de la poésie dans
l'air.
(1) Photographe et réalisatrice. Diplômée de l'école nationale de la
photographie d'Arles avec les félicitations du jury en 2000, Vanessa
Santullo est lauréate des Mécènes du sud en 2010 avec un projet de
court métrage "Les deux tableaux" (titre provisoire), elle a également
bénéficié de l'aide à l'écriture de la Région PACA en juin 2010.
(2) «Etre ensemble» texte de Stéphanie Michut consacré au travail de
l'artiste.
B.B.
Vanessa Santullo - & Alii
Galerie Agnès b
jusqu'au 13 novembre 2010
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
sauf le dimanche
31, 33 cours Honoré d'Estienne d'Orves
Marseille 1er
http://vanessa-santullo.net
VANESSA SANTULLO & Alii
|
SOMMAIRE
Traits perspectifs de paysages
 Mathias Poisson, «Marsoli panorama»
Mathias Poisson, «Marsoli panorama»
Traits
perspectifs de paysages
par Madeleine Doré
Peut importe l'endroit où l'on
se trouve à Marseille, si l'on a le désir de se rendre au MuCEM, on est
obligé de longer le port, de profiter des abords de la mer, de regarder
les bateaux circuler et de faire face au lointain. Cette déambulation
introduit le thème de l'exposition Paysages sensibles, Alger,
Beyrouth, Marseille, Naples... organisée dans le cadre des
rencontres d'Avéroès. Coproduite par le Musée des Civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée, Espace culture
Marseille, l'association able, le Frac
et les Ateliers de l'Image, cette manifestation
pose les enjeux, parfois dissimulés, que propose le paysage.
Penser le paysage méditerranéen par la médiation de l'art, revient ici
à théâtraliser ses mouvances imaginaires, réelles et identitaires. Les
œuvres sont regroupées en cinq catégories : désirs d'horizon, visions
subjectives, matières de villes, espaces ouverts, territoires
convulsés. Le visiteur suit ce parcours suggéré, il arpente l'espace en
découvrant différents points de vue architectoniques d'une ville
figurée.
Ce concept est issu du travail de l'artiste Mathias Poisson. Connu pour
ses déambulations sensibles dans les villes, dans des lieux inusités où
l'expérience des participants est au cœur de ses recherches. Ici
l'expérience du flâneur est intégrée dans une structure muséale.
L'intention première du nomadisme dans l'art contemporain est de sortir
des musées, l'exposition ne traite pas directement d'art nomade mais
plus de la capacité de captation d'artistes voyageurs.
L'œuvre de Poisson occupe la partie principale de l'espace. L'artiste
promeneur est tantôt explorateur de traces, écrivain, dessinateur sur
le vif, cartographe imaginaire, photographe de cartes postales, peintre
voyageur sans limite, il développe une profusion de parcours. Son
itinérance passe par Beyrouth, Naples, Alger, Barcelone et s'arrête à
Marseille. On suit ses évolutions géographiques comme des récits de
voyages, des déplacements ponctués d'arrêts où il réalise de
minutieuses aquarelles, qui ressemblent parfois à de petites
enluminures byzantines.
C'est à l'aide de l'écriture, de descriptions que ses dessins
deviennent des scènes de fictions d'un espace urbain où l'anodin change
de statut par l'attention de son regard.
Une approche in visu et in situ
qui n'est pas sans faire penser à Francis Alys, dont le travail de
marcheur met à l'épreuve l'état des lieux en suggérant parfois la
potentialité du désordre que révèle une ville.
 Mathias Poisson, «Digues de Naples, Marseille, Alger»
Mathias Poisson, «Digues de Naples, Marseille, Alger»
L'exposition rassemble une
vingtaine d'autres propositions explorant le
nomadisme, les expériences en rapport avec le paysage, le territoire,
les frontières. Les trois grands tableaux de Sophie Ristelheuber,
intitulé Drapeau représentent chacun un paysage se distinguant par une
des trois couleurs respectives du drapeau français. Des vues en plongée
énonçant la métamorphose de pays en paysage.
Les villes méditerranéennes sont faites d'histoires dont les images
sont parfois les dérives de reconnaissances affectives et esthétiques
singulières. L'installation de Pauline Fondevila, le marin perdu, se
présente en forme de table. Cette œuvre est une actualisation dynamique
d'un schéma, d'un jeu de piste imitant une sortie en mer, où l'œil
serpente en zigzag la culture méditerranéenne et celle de l'art
contemporain. Un trajet qui ne consiste pas seulement à jouer mais
aussi à tromper. Dans la tradition du paysage, la temporalité se résume
à être l'indication narrative d'un moment de l'histoire. Ici, la forme
symbolique du serpent, illustre, la crainte de se perdre, de perdre
l'image.
Il en est tout autrement pour le groupe d'artistes Stalker qui trace
une cartographie en réalisant un trajet en ligne droite à travers Rome,
en décidant ainsi d'affronter les obstacles qui s'y présentent. Carte
de Rome, témoigne de cette traversée qui abolit frontières et limites.
Cette œuvre appartient à la collection du FRAC, de même que la vidéo de
Zined Zédira. La caméra, témoin oculaire clandestin glane à la lisière
d'une route l'enfoncement du paysage, le passage des gens, le trait qui
profile la route. C'est gratifier le spectateur de l'exercice d'un
regard qui doit à tout instant ressentir que bien voir, c'est aussi
savoir ce qui se passe.
La photographie de Valérie Jouve semble suggérer que fonder le paysage
est une opération de conversion d'un état de nature en un état de
culture. Les relations d'adéquation du sujet dans le paysage
s'effectues par un effet de projection qui rend perceptible les aspects
de la configuration du monde visible. Certaines œuvres de l'exposition
visent l'illusion référentielle du lieu, comme avec la photographie,
Détroit de Gibraltar d'Yto Barrara.
En suivant le parcours de Paysages sensibles, quelques traits
perspectifs du paysage, des visions d'espaces insulaires apparaissent.
L'inventaire se poursuit et l'on ne sait plus si c'est le regard du
spectateur qui se déplace ou si ce sont les choses d'elles-mêmes qui se
présentent. Daniel Arasse a montré que cette dialectique de la
dislocation du regard a été particulièrement favorisée par la peinture
de paysage.
Poisson véritable homme orchestre joue sur tous les tons les accents
méditerranéens, il décline les paysages en occupant l'espace de
monstration qu'il transforme en un espace performatif grâce à des
pictogrammes donnant des instructions d'action aux spectateurs. Face à
l'hyper présence de cet artiste qui est d'ailleurs à l'origine du
projet, la collection du FRAC et la proposition des Ateliers de l'image
qui présentent des œuvres sensibles, font un peu figure de simple
agrégat thématique.
D'où surgit cette intention de donner corps à l'identité
méditerranéenne ? C'est bien ce mouvement que semble proposer le MuCEM,
seul musée national décentré de Marseille dont les travaux avancent
maintenant à grand pas.
M.D.
Paysages Sensibles. Alger, Beyrouth, Marseille,
Naples…
du 5 novembre au 19 décembre 2010
Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
Accès au MuCEM par la Tour d'assaut (môle J4)
Tèl. : 04 91 59 06 87
www.mucem.eu
Traits perspectifs de paysages
|
SOMMAIRE
LA STATION LABORATORIUM
 Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,
copyright laboratorium
Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,
copyright laboratorium
LA
STATION
Halle Sud du Chantier Sang-Neuf, Nice
présente l'exposition
LABORATORIUM
du 12 au 19 novembre à 20h
par Cécile Mainardi
Avec les trois artistes :
Zoé Bornot
Sophie
Graniou
Emmanuelle
Nègre
Un projet conçu en deux volets : d'une part, l'exposition* elle-même
qui scénarise et théâtralise à souhait chacune des pièces, installées
plus qu'exposées, sur une sorte de plateau de tournage décadent,
déjanté, régressif. D'autre part, la projection d'un film, réalisé
entre vernissage et finissage, qui développe les potentialités
scénographiques et imaginaires de l'exposition pour y dresser de brèves
scénettes dans le registre fantastique : un «making off»
post-production en quelque sorte, qui se conçoit comme œuvre d'art
coextensive quoique autonome.
 Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,
copyright laboratorium
Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,
copyright laboratorium
C'est en effet à une absolue
transfiguration de l'espace d'exposition
de la Station, qui a inauguré ses locaux dans les anciens abattoirs de
Nice il y a un an, que donne lieu l'exposition «Laboratorium».
Glissières où pendre les pièces de bœufs changées en rails d'éclairage
de théâtre, espace white cube métamorphosé en quasi train fantôme
labyrinthique, kitch, extravagant... En arrière fond de quoi,
l'imaginaire cinématographique largement balayé, depuis films
indépendants d'un Kenneth Anger (on pense à Puce Moment),
à ceux plus connus du cinéma fantastique (Fritz Lang, Docteur
Mabuse, Dario Argento, et aussi Jerry Lewis, Docter
Jeckyll et Mister Love, à cause de l'exubérante et drolatique
paillasse de laboratoire...) comme vous le voyez par ordre de sérieux
décroissant, puisque il faut dire que l'esprit général N'EST PAS LOIN
DE celui des cartoons.
 Jean-Luc Verna et son groupe de musique en action "I
apologize", le soir du 18 novembre
Jean-Luc Verna et son groupe de musique en action "I
apologize", le soir du 18 novembre
Des trouvailles saisissantes,
voire succulentes : une chambre à la
cohérence architecturale invraisemblablement dévastée ; l'effigie de
Delacroix qui dévoile en transparence d'ex-billets de cent francs une
tête de mort ; une charmante image de jeune fille en noir et blanc qui
s'anime mystérieusement à la surface liquide d'une fiole de
laboratoire...
La Station qui a toujours mené tambour battant UNE INNOVANTE ET FÉCONDE
politique d'exposition et de diffusion de l'art contemporain à Nice,
n'hésite pas ici UNE FOIS DE PLUS à prendre des risques en donnant
carte blanche à de très jeunes artistes, trois jeunes femmes, qui s'en
donnent à cœur joie ! Et l'on s'abandonne volontiers avec elles à leur
souvent vorace, et presque toujours jubilatoire inventivité.
*Le groupe I Apologize (avec l' " apothéotique "
Jean-Luc Verna) s'est produit le soir du vernissage. Performers et
acteurs du process même de Laboratorium, ils ont joué face à un public
en liesse, irradié par l'hypnotique déversage d'images de flammes. Vade
saltatio et exultatio satanas !
C.M.
LA STATION
présente l'exposition
LABORATORIUM
du 12 au 19 novembre 2010
Halle Sud du Chantier Sang-Neuf, 89 route de Turin 06300 Nice
LA STATION LABORATORIUM
|
SOMMAIRE
Espace d'art Le Moulin - BERLIN
- Bernard Plossu
 Bernard Plossu, «Berlin», 2005
Bernard Plossu, «Berlin», 2005
BERLIN
Bernard Plossu
par Xavier Girard
Septembre 2005, Bernard Plossu
est à Berlin pour un vernissage «avec quelques pellicules dans (ses)
bagages». Il n'est pas là pour faire des images. Aucune commande ne le
lie. Mais la ville est bien autre chose qu'une étape de plus dans la
liste des expos. On ne va pas à Berlin on bivouaque dans l'ombre du
temps. Ou plutôt, comme chez Murnau, chaque place, chaque façade,
chaque carrefour est un pont où les fantômes ont vite fait de vous
rattraper. Berlin est un «cinéma filmé», les images y sont précédées
par trop de scènes de cauchemar, trop de réminiscences pour n'être pas
tenté d'y ajouter encore et encore. Mais en cette fin d'été Bernard
Plossu n'a pas la tête à ressasser les visions de la ville disparue.
Dans ces rues où l'on s'attendrait à le voir multiplier les «documents
poétiques» avec juste assez de ce léger tremblé en qui beaucoup voient
sa marque de fabrique, il est tenté par tout autre chose. A la façon du
jeune héros de Thomas Bernhard, dans la Cave, il
prend «l'autre direction». Celle d'un «Berlin blanc», encore estival,
un Berlin de science-fiction qui lui rappelle la lumière de la
Californie, un Berlin semblable à un plateau de cinéma où tout est si
lumineux qu'il se surprend à photographier ce qui jusqu'ici ne le
retenait guère : l'architecture urbaine, la rue, les passants, le
quotidien d'une grande ville riche. Pas envie de «faire du Plossu» (et
pourtant). La promenade à rebours commence. Les «quelques pellicules»
ne suffiront pas.
Le trouble de Berlin l'invite à une sorte de précision en rupture
-toute apparente-, avec sa façon de faire habituelle. Dès la gare de la
Postdamer Platz, il est saisi par la clarté géométrique et la
transparence de la ville. La légèreté paradoxale de la ville de l'ours.
Le vif contraste entre la structure de verre et métal aux angles vifs
et la masse cubiste des immeubles voisins, le retient bien davantage
que la pub au second plan. Et si Berlin, c'était aussi cela : un peu de
lumière matinale sur des pans conjugués, des ombres découpées, un peu
de netteté combinatoire dans le jour qui vient ? La beauté d'un Bauhaus
babylonien ? Un objet architectural, net de toute nostalgie, posé là où
les ruines de l'année zéro formaient un tas d'horreur ? Et si dans
cette vitrine ce tailleur blanc aux sages boutons noirs lui parlait, à
lui, beaucoup plus que les fripes de la guerre ou les hardes de l'ostnostalgie
? Si le blanc et non le rouge et le noir fatidique des années nazies et
le vert de gris lui entrait dans l'œil ce matin là, le premier dans la
ville délicieusement endormie ?
Et si la chorégraphie exacte des voitures blanches et grises qui
s'entrecroisent en bas de l'hôtel faisait oublier un instant les
défilés militaires et la Porsche décapotable des dinky-toys de son
enfance les dernières Trabant ou les Mercedes du Reich millénaire ? Que
regarde t-il ? Des formes lisses, des volumes imbriqués, des gens assis
sur des parallélépipèdes, ombres silhouettées dans la clarté du jour,
des allées claires surgies de la table à dessin des cabinets
d'architecture. Des enfants qui courent. Un bras levé contre le haut
portail d'un H&M. Une jeune femme dans l'&ICIRC;le des
musées, assise devant la Gemäldegalerie, jambes croisées dans
l'ajustement des blocs. Un «air classique» en somme, façon Wallace
Stevens ou Moholy-Nagy. De cette soudaine «objectivité», on aurait pu
déduire que Plossu se serait, à Berlin, senti plus proche de Bernd et
Hilla Becher et de Thomas Ruff que de son cher Robert Frank ou de
Walker Evans. Mais non, rien d'allemand dans ces images d'Allemagne.
Peu de scénographie cette fois et certainement pas de prosaïsme
offensif ou d'essai de typologie, pas de carte d'identité de la ville
non plus. C'est en fait un peu au style d'Atget que l'on pense plutôt.
Le passé se lit au présent à travers la description de la ville
déserte. Le vide qui saisit le photographe est d'une autre nature. Il
est l'espace qui s'interpose tout en lui tournant le dos entre le plan
des apparences et l'émotion du photographe.
 Bernard Plossu, «Berlin», 2005
Bernard Plossu, «Berlin», 2005
Prenez cette image de l'Hôtel
Berlin : on pense d'abord aux paysages
urbains de Gabriele Basilico : même science du cadrage, même exactitude
du détail, même absence d'habitants, même austère objectivité. Comme
Basilico, Plossu fait place aux voitures. Il rend lisible une situation
banale au point de la rendre étrange. Mais contrairement au photographe
milanais, il barre l'image d'un premier plan qui vient contredire la
neutralité de la vue. Le montant de la fenêtre trouble littéralement
l'image à laquelle il fait barrage. L'intimité de la chambre traverse
la ville. Plossu n'en est pas absent. La géométrie de Berlin a beau le
fasciner, il ne fait pas œuvre de géomètre. Les lettres de HOTEL BERLIN
ne se détachent pas dans le ciel vide du document. L'écriture troublée
du premier plan rappelle l'ambition documentaire de la photographie à
son envers : la réalité de l'enquête émotive, l'endroit où se tient le
photographe, la partialité de toute prise de vue. L'insistance mise
dans d'autres images à superposer environnement architectural,
affichage urbain, scène de rue et détail de la vie intime participe de
la même enquête paradoxale. Les berlinois de Plossu sont de préférence
des enfants en train de jouer et des jolies femmes au téléphone
photographiées dans l'espace public, tous modèles également accaparés
par des activités qui les retranchent du monde. Comme si le photographe
se reconnaissait en eux ; à la fois présent et absent, promeneur
étranger dans une ville étrangère, relié à cet ailleurs qu'est
toujours, immanquablement, la plus humble des images.
 Bernard Plossu, «Berlin», 2005
Bernard Plossu, «Berlin», 2005
Deux remarques enfin : A
Berlin, Plossu ne se départ pas d'une sorte de
distance. Il reste à l'extérieur, de l'autre côté. Les rares
personnages photographiés de face sont ceux qui lui sourient du haut
des affiches publicitaires. Le plus souvent les passants apparaissent
de dos ou à contre-jour. Contrairement au touriste qui s'obstine à
«prendre» des photos, Plossu réalise des images qui renoncent dirait-on
à tout «vouloir saisir» et nous touchent pour cette raison même. Il ne
«fait» pas Berlin. Il se tient à quelques pas, il est là sur le seuil
mais n'insiste pas. C'est un bonheur que de voir toute cette lumière
rassemblée sur le saillant des ombres, un bonheur d'autant plus grand
qu'il lui a été donné tel quel, sans qu'il fut besoin de le scénariser.
Cette jolie femme qui s'élance pour traverser est déjà hors de notre
portée. La rencontre n'aura pas lieu. Les passantes ne sont pas comme
les images, elles ne nous regardent pas, elles filent vers leur
rendez-vous. Ce qui surgit ici n'est plus l'image à la sauvette
de la photographie humaniste mais l'instant dans lequel l'image nous
est à la fois donnée et dérobée. La magie du Berlin de Plossu tient
dans ce battement, cet écart entre le monde tel qu'il nous apparaît et
son échappée rendue visible.
A La Valette, Isabelle Bourgeois a convaincu Plossu de montrer la série
des quelques 60 images de Berlin en s'affranchissant de ses deux
formats habituels «le 24 x30 ou le miniature.» Comme «pour les photos
américaines au fonds régional d'art contemporain de Haute Normandie,
avec Marc Donnadieu», Plossu s'est accommodé de photographies de plus
grande taille sans cadre légèrement détachées du mur. La structure des
images et leur objectivité apparente ont certainement rendu ce passage
possible, sans altérer leur qualité première. Un triptyque composé
d'une vue architecturale, (un immeuble monumental), d'une image de
sculpture au coin d'une rue (une sphère surmontée par une colonne) et
le «portrait» d'un vêtement illustre bien la dimension
cinématographique du «Berlin» de Plossu, mixte de photographie urbaine,
de rêverie géométrique et de désir.
Notons en marge de l'exposition de La Valette le choix de Plossu
d'exposer à la Maison de la Photographie à Toulon quatre photographes
ayant pris Berlin pour thème : Melania Avanzato, Nicolas Comment,
Jean-Claude Mouton et Franck Pourcel.
Et recommandons vivement la lecture de l'excellent numéro de Traces -
la revue gratuite du Moulin qui accompagne l'expo - avec une
conversation entre Isabelle Bourgeois et Bernard Plossu, et des textes
de Alfons W. Biermann et Luc Benito.
X.G.
Bernard Plossu
« BERLIN »
du 23 novembre 2010 au 22 janvier 2011
Espace d'art Le Moulin
8, av. Aristide Briand 83160 La Valette-du-Var
du mardi au vendredi de 15h à 18h
et samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
entrée libre
Espace d'art Le Moulin - BERLIN
- Bernard Plossu
|
SOMMAIRE
L'atelier des images : Rétine
Argenique
 Bernard Pesce, série " le non-dit ", 2010
Bernard Pesce, série " le non-dit ", 2010
L'atelier
des images :
Rétine Argentique
par Xavier Girard
Laboratoire photographique
professionnel, rétine argentique est aussi, depuis son ouverture en
avril 2010, un lieu d'exposition photo parmi les plus stimulants de la
région. Nicolas et Stéphane en ont pris la direction alors que le tout
numérique sonnait le glas de nombre d'agences et de labos spécialisés.
85 rue d'Italie, près de Castellane, les photographes connaissent
l'adresse : Jacques Bambini y tirait depuis longtemps leurs images en
grand format avant de prendre sa retraite. Ni argentiques à tout crin,
ni numériques intégristes, ils sont d'abord à l'écoute des photographes
et des exigences spécifiques de chacun. Travailler avec eux fait
parfois songer aux ateliers les plus traditionnels, ceux dans lesquels
la technique se tient au plus près de la recherche artistique. Pas d'a
priori esthétique, pas de protocole immuable qui tienne : le
laboratoire est à la recherche de la solution la mieux adaptée aux
objectifs des photographes. La compréhension du projet est ici
déterminante. Affaire de sensibilité et d'efficacité. Leur première
exposition consacrée à Valérie Debray présentait des images réalisées
avec le portable de la photographe. Le pictorialisme de ces beaux
tirages à gros grain prenait le contrepied des images lissées et
parfaitement égales de l'esthétique numérique. En un tel lieu, le "
bruit " des tirages avait quelque chose de réjouissant. Rétine
argentique prenait le parti des artistes contre le précisionnisme
agressif de l'imagerie, sans délaisser les prouesses techniques. Ils ne
manqueront pas sur cette lancée d'agrandir nombre d'images " IPhone,
IPad, SmartPhone " qui leur seront apportées. Puis se succèderont les
expos de Alain Brunet et Angelica Julner. Récemment Rétine argentique
exposait les images de Bernard Pesce.
Nota bene : régulièrement Stéphane et Nicolas organisent des
dégustations œnologiques. L'alchimie des images et les divinités du vin
n'ont rien d'anachronique.
X.G.
retine.argentique@gmail.com
www.retine-argentique.fr
Marseille
L'atelier des images : Rétine
Argentique
|
SOMMAIRE
Sauvetage de la Tangente
Nicolas Gilly Laurent Le Forban Marrie-Joséphine Foehrlé Anje Poppinga
 Laurent Le Forban
Laurent Le Forban
Sauvetage
de la Tangente
Nicolas Gilly
Laurent Le Forban
Marrie-Joséphine Foehrlé
Anje Poppinga
par Jean-François Meyer
La Tangente est en difficulté.
L'association SPRAY propose de reprendre le lieu et les charges et la
programmatoion dans le même esprit. Nicolas Gilly, le successeur du
talentueux Mika Biermann, continuera le travail entrepris. A ses côtés
Laurent Le Forban qui expose actuellement, Marie-Joséphine Foehrlé et
Anje Poppinga, la présidente de SPRAY l'aideront à former une bande de
quatre.
Les caisses sont vides ! Un généreux donateur Hans Nawrocki couvrira
les frais de fonctionnement jusqu'à l'obtention des aides publiques.
Quant à François Gilly... Le vaillant retraité est toujours là.
La tangente, un lieu ouvert dans l'espace couvert du marché aux puces
où l'on trouve comme dans certaine galerie du centre des expos, des
performances mais aussi de la philo (le groupe C.E.S.A.R), des
conférenciers comme Charles Floren ou de la danse.
 Laurent Le Forban, exposition du 13 novembre au 12
décembre 2010
Laurent Le Forban, exposition du 13 novembre au 12
décembre 2010
Partenaire de La Poissonerie et
du Lièvre de Mars, la galerie attire
les dimanches midi une joyeuse faune, on aurait dit bohême, qui fait le
bonheur des antiquaires du même couloir.
SPRAY, rappelons-le, est cette association, qui avait organisé en 2004
la manifestation «13001 Frioul». SPRAY dont le fondateur a fait
«fortune» avec les bénéfices de la publicité de son premier tour du
monde sur son bateau SPRAY. Reparti pour un deuxième tour du monde,
sans doute en oubliant de se boucher les oreilles, il n'est jamais
revenu.
Mais ce samedi 13 c'est Laurent qui a envahi l'espace et si dans un des
textes-objets qu'il a installé sur un mur il conseille de ne pas faire
aujoiurd'hui ce qu'on pourrait oublier de faire demain il ne va pas
moins passer à l'action avec sa complice Laure Maternati. Tandis qu'il
a disposé sur le sol à une dizaine de mètres de distance 4 ou 5 postes
de radio, Laure après s'être concentrée avant l'effort va
systématiquement et sans pitié les écraser avec ses chauusures les uns
après les autres et couper ainsi le sifflet de façon salutaire aux
commentateurs sportifs ou aux expertes en politique et en économie qui
croyaient de leur devoir de rabattre les oreilles d'un auditoire soumis
avec ce qu'ils appellent de l'information et qui ne peut être que la
vérité... du sport.
Laurent Le Forban, vue de l'exposition à la Tangente,
Marché aux puces de Marseille - Hall des antiquaires

http://la.tangente.free.fr
association SPRAY : pour écrire
Sauvetage de la Tangente
Nicolas Gilly Laurent Le Forban Marrie-Joséphine Foehrlé Anje Poppinga
|
SOMMAIRE
Zineb Sedira
 Zineb Sedira, «The Lovers», 2008, Photographie
couleur, 120 x 100 cm , © Zineb Sedira
Zineb Sedira, «The Lovers», 2008, Photographie
couleur, 120 x 100 cm , © Zineb Sedira
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
Zineb
Sedira
par Xavier Girard
Zineb Sedira manie avec une
grande efficacité et un usage éprouvé des techniques de l'art
contemporain (cibachromes de grand format, caissons lumineux, double ou
triple vidéo-projections, etc.) les lourds symboles de l'impossible
«maison commune» de la méditerranée. Maison hantée (Haunted
house, 2006), murs (Framing the view,
2006), rivages désolés (Escaping the land, 2006),
carcasses de bateaux rongées par le sel (Shipwreck,
2008, Floating coffins, 2009, Shattered
carcasses, 2008), containers et cargos échoués dans les
sables (Reusable space, The death of the
journey, 2008), horizons perdus, solitude du passager face à
la mer... Mais le succès de ses expositions ne tient pas seulement au
caractère spectaculaire - que certains qualifieront d'un peu trop
académique à leur goût et quelque peu pompier - de ces objets à forte
réactivité symbolique, il est grandement dû à la rencontre, dans les
lieux les plus prestigieux de l'art contemporain, de l'histoire du
peuple algérien et des formes les plus caractérisées de la production
de l'image plasticienne des années 2000. L'empressement des
institutions (qui l'exposent et lui attribuent force prix et
récompenses) et des galeries (Kamel Mennour en France) à se saisir de
cette rencontre a le mérite de susciter un commencement de réflexion.
Voilà un art qui tout en prenant en charge un pan encore grandement
inexploré (en dépit d'une filmographie importante et de nombreux
ouvrages sur le sujet) de l'identité algérienne d'aujourd'hui et de ses
lignes de partage culturel, linguistique, religieux entre le pays
d'origine et les pays dits, par euphémisme d'accueil, emprunte au
vocabulaire de l'art contemporain ses standards visuels et ses
dispositifs les plus performants. Nul doute que l'impact de la belle
image du désastre comble un très ancien et très universel désir de
représentation. La beauté des bateaux en ruine de Zineb Sedira saute
aux yeux. Tous les Sindbads, tous les Ulysses de la terre y
reconnaitront leur hantise d'une traversée impossible, l'échec d'une
mer divisée, le naufrage des illusions impériales ou bien encore les
vestiges de la Course du Grand Siècle et de ses avatars modernes. Sa
maison hantée est un magnifique monument du colonialisme défunt. Ses
containers ensablés et transformés en cabanes prennent à revers
l'économie du transport mondialisé. La méditerranée que peint Sedira ne
ressemble pas aux cartes postales de la croisière festive. Elle résiste
aux discours d'invocation des spécialistes d'une mer plus imaginaire
que réelle, celle de Camus à Braudel en passant par Audisio et Ballard.
Elle ne flatte aucune conciliation de surface. Sa réalité est assignée
à résidence de l'autre côté des murs que l'histoire a dressés entre ses
rives. Murs que ses vidéos tentent en vain de franchir en interrogeant
les membres de sa famille.
 Zineb SEDIRA, «Don't do to her what you did to me»,
1998-2001, Still extrait de la vidéo - 9 min, © Zineb Sedira
Zineb SEDIRA, «Don't do to her what you did to me»,
1998-2001, Still extrait de la vidéo - 9 min, © Zineb Sedira
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
Mais à y regarder à deux fois,
un doute s'insinue. Ces ruines et ces
épaves ne sont-elles pas aussi de formidables attractions du point de
vue de l'autre rive ? Le spectacle non de la fin de l'aventure
impériale mais des laissés pour compte de l'histoire ? Les cargos de
Sedira disent-ils l'enfouissement dans les sables de l'identité ou les
cimetières désaffectés de la colonisation ? Quelle réaction que la
notre devant ces fortes images dont le style fait parfois penser à une
pub ? Quels objets souvent monumentaux, posés sur la table de
l'introspection, nous sont ici proposés ? Et à quel type d'intellection
font-ils appel ? De quoi ce nouvel esprit des ruines est-il le nom ? Et
de quel malentendu exemplaire ? D'une «quête identitaire» ? Celle d'une
artiste née à Paris de parents algériens, vivant à Londres et exposant
dans le monde entier cherchant à travers le dialogue entre les
générations (dans Mother Tongue, 2002, Retelling
Histories : My Mother Told Me, 2002, Mother, Father
and I, 2003) à renouer les liens rompus ? Est-il question ici
de la nostalgie d'une Algérie heureuse (comme dans Saphir, 2006, qui
prend l'hôtel fétiche de l'Algérie coloniale - le vieil Aletti -, pour
théâtre) ou d'un message plus générique ? S'agit-il de la dénonciation
des injustices commises au nom de l'idéologie coloniale ou d'une
méditation sur la chute des empires ? D'un exercice de la mémoire
personnelle, empêchée par l'exil ou d'un propos convenu sur les
désastres de l'histoire ? De la fascination pour le naufrage ? Des
blessures de la guerre dont la récente polémique autour du terme de
collaborateur à propos des Harkis montre à quel point elles sont encore
à vif ? Les divers entretiens de Sedira avec la presse ne répondent pas
à ces questions, pas plus que ces grands polyptiques lumineux et ses
vues encadrées de noir. Certaines d'entre elles pourraient être
réalisées de ce côté ci de la méditerranée, entre le vallon des Auffes
et les plages du Languedoc.
Mais, se dira t-on, l'artiste n'est pas sommé de répondre. L'équivoque
de l'œuvre fait partie de sa creativ method. Pour
le reste il y a de fortes chances pour que les programmateurs
d'expositions méditerranéennes en mal d'œuvres plus consensuelles qu'il
n'y paraît à première vue la sollicitent sans hésiter.
X.G.
Zineb Sedira
«Les rêves n'ont pas de titre»
du 19 novembre 2010 au 27 mars 2011
[mac] musée d'art contemporain de marseille
69 avenue d'Haïfa, 13008 Marseille
Zineb Sedira
|
SOMMAIRE
Athanor réouvre temporairement
- avec Sibylle Baltzer
 Sibylle Baltzer, Photographie J.C. Lett
Sibylle Baltzer, Photographie J.C. Lett
Peinture
/ Assemblage / Répartition / Partition
par Florent Joliot
« Je cherche un langage qui soit
pétrit d'une matière »
Sibylle Baltzer
Pour une dernière exposition, pour Sibylle Baltzer, la Galerie Athanor
a réouvert ces portes du 5 rue de la taulière.
Cet événement n'est pas dépourvu de sens dans cette galerie qui gérée
par Jean Pierre Alis a défendu l'art à Marseille depuis 1972 sans
jamais désavouer son intérêt pour la peinture. En effet, cette galerie
qui expose très tôt les artistes de Supports/Surfaces (Bioulès,
Dezeuze, Viallat, Dolla, Valensi, Grand...) par ce nouvel accrochage
assume jusqu'au bout ce que l'on pourrait qualifier de ligne directrice
au travers de son rôle de prospecteur de nouveaux talents.
 Sibylle Baltzer, Photographie J.C. Lett
Sibylle Baltzer, Photographie J.C. Lett
Si Sibylle Baltzer accepte
pleinement sa filiation aux mouvements de la
fin du 20 siècle tels que le minimalisme, l'Arte Povera, Support
surface (elle a suivi les cours de Claude Vialat), il n'en reste pas
moins qu'assumant son héritage, elle s'en émancipe l'intégrant pour ne
pas dire le désintégrant , en le diluant dans sa pratique ; Empruntant
son sens formel aux uns, son approche conceptuelle aux autres, et
puisant également dans un répertoire d'artistes outre-atlantique tels
que Richard Tuttle, Phyllida Barlow ou Mary Heilmann autant que dans
son environnement immédiat.
L'artiste présente quelques grandes toiles, lumineuses, terrains
d'affrontements entre les aplats et les vides, la matière-support et la
matière-surface. Elle joue de la notion de frontières et d'empilements,
travaillant la limite entre «le peint» et «l'ajouré», laissant
apparaître et composant avec la matière-même de la toile en traitant
les surfaces de peintures comme des formes autonomes à la lisière
déchirée ; Tant et si bien que l'on pourrait penser avoir affaire à des
collages !
 Sibylle Baltzer, Photographie J.C. Lett
Sibylle Baltzer, Photographie J.C. Lett
Les autres œuvres présentées en
fond de galerie procèdent plus
directement du collage, ou de l'assemblage d'objets, de morceaux
trouvés, en bois, plastique caoutchouc, métal, polystyrène, matières
issues du quotidien... Le tout lié dans sa rythmique par la forme, la
couleur. L'artiste puise dans la figuration du matériau, ce qu'il livre
en tant que matière, forme, mais aussi en tant que trace, résidu qui
procède d'une archéologique du quotidien.
Elle assemble donc ce qu'elle qualifie «d'éléments parfaitement
figuratifs du réel» pour ensuite l'abstraire de son contexte en le
liant au reste par la juxtaposition, jouant des interstices et des
ruptures pour créer le tout. En cela elle se démarque très nettement de
l'Arte Povera qui fasciné par son essence glorifie le matériau pauvre.
L'effet troublant de ces assemblages, réside dans l'impression qu'une
fois équilibrés, harmonieux, ils se trouvent en quelque sorte réalisés,
autonomes au point qu'on a peine à les démembrer intellectuellement, à
les considérer pièces par pièces. Le liant de ces sculptures-plans
restant la composition par la couleur, on a définitivement le sentiment
d'avoir affaire à des superpositions picturales jouant de leur
épaisseur, de leurs ombres sur le mur/toile... En un mot à de la
peinture.
Ainsi, si Sibylle Baltzer assimile l'héritage de Richard Tuttle qui
perçoit le collage comme un outil, un procédé qui permet de
«représenter l'espace intellectuel de la peinture», elle l'étend à ses
grandes compositions picturales, procédant un retournement en
pratiquant un collage que l'on pourrait qualifier de pictural.
L'œuvre de Sibylle Baltzer est infiniment sonore, dans sa composition
comme dans sa perception. En effet, on sort d'une exposition de son
exposition, comme on sort d'un concert : les formes, les couleurs, les
silences persistent dans la tête au-delà de la persistance rétinienne.
Ainsi, à travers une libération du matériau, de la surface, de la
couleur ou de la ligne, l'oeuvre ne figure pas, elle est pour reprendre
un autre terme cher à Richard Tuttle «un monde à part entière» ; Ici un
monde assemblé notes par notes, fait d'harmonies comme de dissonances
maîtrisées, le tout tenant ensemble par-delà la partition, dans ses
vides comme dans ses pleins, dans ce que Zoé Valdès qualifie de
«Fragilité discordante des formes».
F.J.
Sibylle Baltzer
«Bubble Gum - Peintures Récentes»
du 13 octobre au 27 novembre 2010
Galerie Association Athanor
5, rue de la taulière, 13001 Marseille
Tèl. : 06 70 86 89 81 - 06 78 86 81 73
rmisraki@wanadoo.fr
Athanor réouvre temporairement
- avec Sibylle Baltzer
|
SOMMAIRE
Julien Blaine - DéRêVeR
 Julien Blaine, Déclara©tion le
mardi 28 septembre, Photographies de Fabrice Beslot
Julien Blaine, Déclara©tion le
mardi 28 septembre, Photographies de Fabrice Beslot
Julien
Blaine : « Avant d'en être sûr je voudrais te dire deux ou
trois choses : "Comprends-tu ?" »
par Jean-François Meyer
C'est une nombreuse assistance
qui se presse dans la salle d'exposition du théâtre de Privas
accueillie par le directeur Dominique Lardenois, son assistante
Françoise Ridet et Fabrice Beslot, l'artiste performeur
Fabrikdelabeslot, qui a la responsbilité de la programmation des
expositions pour les années 2009 et 2010.
L'adjointe à la culture de la ville, Dominique Buis, prend le micro :
«Au bout du bout de l'art d'avant-garde nous avions la toile
monochrome, une fenêtre sur le vide, un trait de lumière, et puis c'est
l'éternel retour qui inspire Julien Blaine.
Il demande aux artistes du monde entier de se faire chaman de la
préhistoire, d'inscrire leur main enduite de couleur dans la pierre.
Quel culte célèbre-t-on, quelle divinité ? Et si c'était la paix
universelle, et si ces galets n'armaient jamais une fronde ? Le symbole
c'est deux morceaux d'un même objet, signifiant la promesse d'un
retour. Ces galets peints réalisent à l'infini l'union universelle.
Art primitif redécouvert, trouvaille des galets du monde, attestée par
la photographie du lieu d'origine. La photographie c'est
l'aboutissement de la recherche humaine pour capter l'image. Nous avons
même grâce aux techniques de la science conjuguée à l'artistique ( ce
qui n'est pas contre nature ), la reconstitution du visage d'une jeune
magdalénienne et d'une azilienne de 15000 ans. Le féminin c'est
l'origine du monde, des vulves pariétales aux Mystères d'Eleusis,
jusqu'au tableau de Courbet, les artistes ont tenté d'appréhender les
secrets des Mères. Et puis "Du geste à la parole" (ouvrage fondateur de
Leroi-Gourhan), les hommes se sont aventurés à communiquer toujours
plus : ils ont affiné les phonèmes, ils ont fini par écrire. Julien
Blaine s'est fait artiste-archéologue pour reconstituer le support de
l'écriture. Maintenant qu'il a dégagé le cri de l'écriture, la vie de
l'envie et le tué de reconstitué, il lui semble avoir atteint le cœur
de la révélation que tout est dans tout : "Je n'ai plus envie
d'écrire". A nouveau le bout du bout de la démarche esthétique ?
Bien sûr Julien Blaine expose en terre ardéchoise car il y a trouvé
quelques réponses aux questions existensielles des humains : au fond de
la grotte Chauvet dont les parois semblent séparer le monde des vivants
de celui d'un au-delà, dans les livres de l'équipe de chercheurs
dirigée par J.P. Clottes. Partout sur ce territoire vivarois les hommes
du passé ont laissé leur empreinte. S'il est un lieu où le mystère des
origines peut nous être conté c'est bien ce département. Julien Blaine
est-il arrivé au bout de son cheminement ? Espérons que non.
Les archéologues qui continuent de fouiller et les artistes comme
Julien Blaine nous permettent de suivre les petits cailloux que l'homme
a toujours semé derrière lui pour qu'on le trouve et il reste bien des
petits Poucet néanderthaliens, tautaveliens, aziliens à sauver de
l'ogre Chronos.
Est-ce cela dérêver ? S'attacher à se dégager du mystère et montrer ?»
Les lumières s'éteignent et dans la salle d'exposition devenue grotte;
le poète aurignacien s'avance dans l'obscurité. Quelques sculptures en
néon, comme des torches jettent des lueurs sur ce visage qu'il est en
train de farder.
L'ocre, le rouge, le bleu et le vert vont perpétuer le rituel de ses
ancêtres, les nôtres également si bien qu'on n'aura pas trop de mal à
s'imaginer revivre ce qu'on n'a jamais vécu. Et me reviennent ces (ses)
mots de "La cinquième feuille" «...je bleuis ou je tiens je bleuis où
je tiens , je jaunis ou je me détache je jaunis où je me détache, je
brunis où je me tiens je brunis ou je rougis ou je noircis ou je
blanchis où jadis je verdis»
Rituel qui n'a pour lui que l'occurence de son repérage dans
l'imaginaire, dont on ne peut dire qu'il a été ou pas mais dont
l'existence est pourtant primordiale.
Le doute salutaire et la croyance inévitable s'affrontent dans la
réflexion sur la fulgurance de l'intuition aux supputations audacieuses
qui vont ouvrir la voie du connaissable.
La vérité, la croix des logiciens ou comme le dit Philippe De Rouilhan
dans "Russel et le cercle des paradoxes" «Pourquoi dire le vrai mais
comment dire le faux»
Les hommes si attachés à la vérité, cette vérité qui tue depuis des
millénaires, qui a ensanglanté l'histoire des hommes dans l'enfer du
oui.
Le poète élémentaire, qui a libéré la langue incarcérée dans le sens
autant que dans la bouche, joue sur les mots, leur parallélisme, leur
sens à géométrie variable, sur les rapports entre leur profondeur et
leurs effets de surface.
La déformation peut paraitre adventice elle était déjà là, elle
attendait son inventeur. Comme le chiendent, l'ivraie, la cuscute elle
s'était plantée toute seule.
La parole n'est pas sacrée ni univoque, elle est mutante, elle renferme
des gisements comme les galets aziliens, les signes qu'il nous reste
d'eux, des signes dont il ne resterait que le signifiant.
Quand on n'en sait rien il vaut mieux n'en rien dire mais c'est la
meilleure façon de ne jamais rien en savoir. Plutôt l'interrogation et
l'invention, comme on invente un trésor.
S'agit-il de faire revivre ce que l'on n'a jamais vu et qui n'a
peut-être jamais vécu ?
C'est sûr. Il s'agit de faire revivre enfin ce qu'on n'a jamais connu.
J-F.M.
Julien Blaine
«DéRêVeR»
De la grotte Chauvet à celle du Mas d'Azil
Qu'est-ce qu'ils voulaient dire ?
Installa©tion(s) & Déclara©tion(s)
mots/objets/dessins/vidéos
du 29 septembre au 27 novembre 2010
Julien Blaine - DéRêVeR
|